L’engagement, c’est dépasser le fait d’interpréter le monde, c’est le transformer1
Par Christophe Pruvot
L’engagement pour la philosophie est un idéal. L’engagement en pédagogie est un acte pensé pour la transformation sociale et politique. Lorsque l’on s’engage à partir d’une réalité dégradée, on ne choisit pas l’environnement mais on cherche l’amélioration de l’existence. Notre engagement ne va pas être exceptionnel, il ne va pas être sensationnel. Nous allons nous inscrire dans le paysage. Cet engagement nous oblige à ne pas maitriser mais à avoir une approche matérialiste et pragmatique, un travail dans les conditions réelles, la connaissance de la réalité sociale nous obligent à améliorer cette réalité.
S’engager, c’est d’abord commencer
Il existe un commencement ou un point de départ, Il existe une incitation qui va entrainer un acte et le sujet se lance dans quelque chose. On peut se lancer sans savoir toujours où l’on va. S’engager implique une certitude parce que c’est une décision, mais s’engager est marqué, aussi, par une incertitude : il existe l’imprévu, l’inattendu. S’engager est une réponse en acte : une réponse à une situation, à une urgence parfois. C’est cette urgence, cette situation (vue, vécue, apprise) qui est le point de départ. Quand je m’engage, je me demande ce que je fais. Donc s’engager serait se décider à agir, ici et maintenant. On ne peut pas s’offrir le luxe d’attendre et toujours spéculer. On peut agir avant de savoir comment bien agir et on voit cela chemin faisant. S’engager, c’est un peu faire ce qu’on peut mais c’est être responsable car c’est regarder vers l’avenir.
S’engager, c’est reprendre et mettre en gage
Reprendre la situation en main, c’est un pas vers la liberté pour reprendre une idée chère à Jean Paul Sartre2. Cette dimension pragmatique est une manière de faire quelque chose de ce qui nous est donné. Si l’engagement est lié au passé, ce n’est pas se libérer, c’est prendre ce qui est donné pour mieux s’en servir. Sartres est connu et reconnu pour être un intellectuel engagé. Pour Sartre, l’engagement est un état de fait (comme pour la liberté) lié à la condition humaine. L’homme est condamné à l’engagement (comme il est condamné à être libre). « Je suis jeté dans le monde ». Ou comme le disait Pascal3 : « Nous sommes embarqués ». L’engagement devient alors une obligation morale qui est en situation et ancré dans le réel. La notion de responsabilité est importante pour Sartre. L’homme est engagé dans un monde qu’il crée et auquel il donne du sens, il choisit ses valeurs et s’engage. L’homme doit répondre de ses choix devant l’humanité. L’engagement, c’est dépasser le fait d’interpréter le monde, c’est le transformer. Et c’est de cette responsabilité dont il est question en philosophie, en pédagogie. L’engagement est de circonstance, c’est être dans le présent et c’est parier sur l’avenir. Donc, c’est mettre en gage quelque chose : sa personne, son temps, sa connaissance.
Et si Marx affirmait que « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c’est de le transformer », nous pouvons, aujourd’hui, soutenir que la philosophie doit permettre de comprendre le monde, de ne pas se satisfaire de ce qui existe et de penser la transformation de ce monde. La philosophie doit, aussi, être en acte : c’est pour cela que nous avons besoin d’une pédagogie pour agir sur et dans le monde : une pédagogie émancipatrice, libératrice, libertaire et sociale.
S’engager, c’est donner sa parole
Nous avons vu que l’engagement est lié à l’action mais il est important d’affirmer qu’il est aussi lié à la parole. C’est en disant (ce que l’on fait, ce que l’on pense) que ça (l’acte, la pensée) existe : l’engagement est un faire savoir. L’engagement doit se faire voir, se manifester. La sphère de l’engagement est publique car en manifestant son engagement, je me lie à autrui. La parole est un acte très différent de l’écrit. Le texte écrit ne prend pas le risque de la confrontation (directe). Il n’y a pas d’engagement qui ne passe pas par la parole parce que cette parole est publique, elle rend visible, elle se manifeste et elle manifeste.
L’engagement est social
C’est la conviction : l’action n’a aucun sens sans le sujet qui l’accomplit. C’est la différence avec l’œuvre qui elle subsiste sans son auteur. Donc, s’engager révèle un sujet. S’engager, c’est donner en gage sa personne. L’action est temporelle, elle est insérée dans le présent vivant. Parfois l’engagement est le petit, il est le « minuscule » de l’initiative devant la mondialisation, l’individualisme et le monde marchand. Mais il n’y a pas d’engagement sans raison d’agir et sans envie d’agir : devant l’indécis, l’être engagé est décidé. Annah Arendt4 écrivait : « l’engagement est un ilot de certitude dans un océan d’incertitude ». L’engagement convoque le soi en soi, il est du registre de l’être et non de l’avoir : on EST engagé. Nous devons nous poser la question des valeurs (des convictions). Les valeurs sont une des raisons de l’engagement. L’engagement est un acte qui met en jeu son être entier, sa vie matérielle et son affect.
La prise de conscience
Le fait de s’engager se situe entre une prise de conscience et un passage à l’acte. Aujourd’hui, la précarité, la pauvreté, les discriminations, les inégalités, les menaces écologiques sont le terreau de la prise de conscience. Ces prises de conscience devraient entrainer de nouvelles solidarités et une nouvelle morale selon Miguel Benasayag5. Mais comment trouver le chemin de l’engagement ? Il y en a qui s’engagent et d’autres non. C’est passer de l’indignation à l’action. Certains citoyens ont une attitude hésitante et ne vont pas s’investir peut-être à cause de l’individualisme et de la peur du groupe car l’engagement est collectif. Certains ressentent une forme d’impuissance au risque de passer pour « le salaud » ou « le lâche ». Pour Sartre, si on trouve une situation injuste, notre responsabilité peut nous faire sauter le pas. C’est le libre choix6. Pour Kant : on doit agir. Les individus doivent obéir selon une loi morale qui serait désintéressée et universelle7. On ne se pose pas la question, on agit devant une situation injuste. Dans l’engagement, il y a une souffrance personnelle. C’est lié à une douleur, une frustration. On s’engage car on est confronté concrètement à une situation. C’est la prise de conscience. L’engagement commence quand on se joint à l’autre. L’engagement est parfois lié à un héritage à une histoire familiale et personnelle forte : « on est tombé dedans quand on était petit ». L’engagement peut aussi casser le cercle vicieux de la peur, du repli sur soi et de l’individualisme (Miguel Benasayag). C’est une vision empruntée à la pensée de Spinoza8 : on augmente sa puissance, sa joie quand on passe à l’action avec d’autres, on quitte « la simple petite vie personnelle » qui ne permet que la survie pour aller vers la puissance. Pour Spinoza, c’est triste de ne voir l’engagement qu’avec l’espoir du lendemain. Il faut espérer pour demain mais aussi pour aujourd’hui. La vision de Spinoza est ancrée dans le « ici et maintenant », dans le réel. Il y a de la joie tirée de l’engagement : c’est un souffle pour la politique et c’est une raison d’être.
L’engagement et les luttes
Depuis quelques temps, il n’est pas rare d’entendre que nous assistons à la fin de l’idéal révolutionnaire : c’est la disparition de l’idée du « grand soir ». Est-ce à cause de la chute du régime soviétique de l’Europe de l’Est (avec la chute du mur de Berlin) ? Est-ce depuis le « il n’y a plus d’alternative » (« There is no alternative ») de Thatcher9 ? Ce qui est certain c’est que depuis la fin des années 80, le capitalisme (industriel puis financier) est le seul système qui se développe dans l’espace monde : la mondialisation est le capitalisme. Il n’y aurait pas d’autres choix, le système capitalisme et sa culture néolibérale s’imposent comme naturel : la loi du marché devient la logique du marché, la logique financière. La fin de l’idéal révolutionnaire est alors une problématique pour l’engagement. Mais regardons de plus près les effets du système ou les expressions de l’oppression, de la domination, de l’exploitation : individualisme, compétition, disparation des collectifs, inégalités, pauvreté, misère, précarité, racisme, sexisme… Selon Furtos10, lorsque les personnes sont enlisées dans la précarité sociale où se trouvent sur cette pente glissante et interminable de la précarité, elles vont perdre la confiance en elles, en l’autre et en l’avenir. Avec la peur de l’avenir, les personnes n’espèrent plus. Pour s’occuper de la chose publique, pour faire de la politique, il faut être serein : les affaires de la vie quotidienne doivent être « réglées », il faut pouvoir subvenir sans crainte à ses besoins. Être du côté des opprimés est un acte (un engagement) politique en répondant aux besoins, en apportant des sécurités, en donnant, en distribuant. Si la précarité empêche d’envisager l’avenir, il faut considérer l’engagement comme Spinoza pour transformer le quotidien ici et maintenant, pour que les luttes soient en proximité et locales. Il faut faire de la politique là où elle est absente, là où elle a disparue : dans les quartiers populaires, avec les minorités, pour les plus pauvres. Il faut un engagement d’éducation populaire et politique là où les choix politiques ont le plus d’effets, là où les décisions politiques font peur, là où elles créent plus de misères, d’inégalités et d’injustices.
Est-ce qu’on s’engage seulement lorsqu’on est acculé ? Est-ce qu’on s’engage quand on est affecté par les injustices et les inégalités ? Selon Marx11, seuls les dominés peuvent le changement. Paulo Freire12 travaillait avec les opprimés et travaillaient à la prise conscience des oppressions pour une mise en mouvement et une émancipation collective. Chacun d’entre nous peut jouer un rôle, avoir une place, prendre des responsabilités sur le chemin de l’engagement, de l’espérance : les dominés, les chercheurs, les militants, les intellectuels. L’intellectuel, le chercheur ne doivent pas s’écraser au regard d’un devoir de qualité scientifique. Ils ont le devoir de l’ouvrir. L’engagement, en ce sens, c’est être dans une direction et de se positionner. Il faut rejeter la neutralité (il y aurait les engagés et les neutres) : le neutre est du côté du dominant donc engagé pour le maintien de l’ordre en place. Prétendre ne pas avoir de militance, c’est avant tout être « militant de l’ordre des choses ». Tout comme le pédagogue (praticien-chercheur), le chercheur a une responsabilité politique et cela revient à dire que pour un chercheur prendre cette responsabilité, c’est « faire son boulot »13 : être au travail sur le chemin de l’espérance, un chemin présent et un travail « déjà-là »14.
1 Phrase prononcée par les légionnaires romains dans les albums d’Astérix et Obélix (René Goscinny et Albert Uderzo).
2 Pour Jean Paul Sartre, l’homme n’a pas le choix, il est responsable de sa liberté.
3 Blaise Pascal est un philosophe du XVIIème siècle. Pour Pascal nous sommes dans l’obligation de choisir.
4 Annah Arendt est une philosophe, politologue et journaliste du XXème siècle.
5 Miguel Benasayag est philosophe, psychanalyste et chercheur en épistémologie – Franco Argentin
6 Pour Jean Paul Sartre la liberté est choix.
7 Loi morale universelle : pour Kant, l’homme est un être raisonnable, il se donne à lui-même sa propre loi et celle-ci à valeur universelle.
8 Baruch Spinoza est un philosophe du XVIIème siècle. Pour lui a puissance d’agir de l’être humain est liée à la joie et au désir.
9 Margaret Thatcher arrive au pouvoir au Royaume Uni en 1979 et clame un « There is no alternative » en 1980 : « il n’a pas d’autres choix », « il n’y a pas de plan B » sont des variantes régulièrement entendues par les dirigeants pour affirmer que la seule solution pour le monde est le néolibéralisme.
10 Jean Furtos est psychiatre. Furtos J., De la précarité à l’auto-exclusion, Rue d’Ulm Eds, 2023
11 Karl Marx (1818 – 1883), philosophe, sociologie, économiste, etc. Théoricien de la révolution socialiste et communiste.
12 Paulo Freire (1921 – 1997). Pédagogue brésilien connu pour son engagement au côté des opprimés. Freire P., Pédagogie des opprimés, éd Agone, 2021 / Freire P., Pédagogie de l’autonomie, éd Érès, 2006
13 Friot B., Lordon F., En travail Conversations sur le communisme, La dispute, 2022
14 Friot B., Lordon F., En travail Conversations sur le communisme, La dispute, 2022
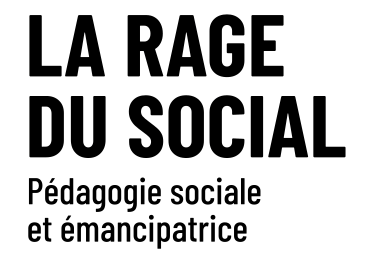
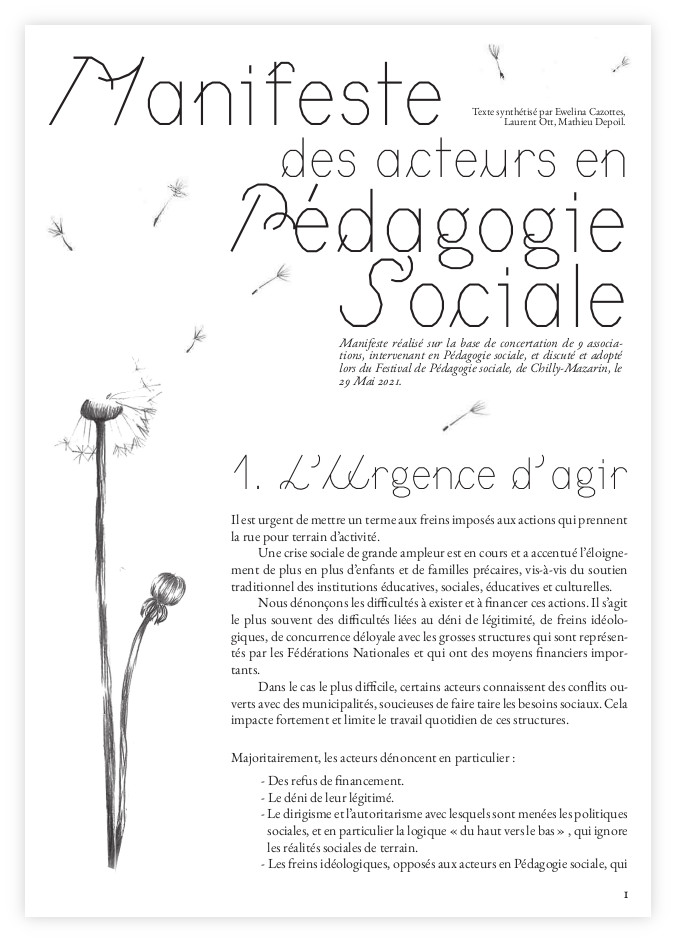

Laisser un commentaire