Par Pierre Dugué
Le travail social change, ses professionnels s’adaptent aux nouvelles contraintes du quotidien. Il en va de même pour ce qui concerne les pratiques, mais aussi les conceptions idéologiques des professionnels des métiers à l’adresse d’autrui. De ces évolutions naissent des conceptions nouvelles, et les rapports professionnels entre générations nous semblent recouvrir une piste d’analyse particulièrement féconde pour mieux cerner les évolutions de la professionnalisation des éducateurs spécialisés.
Approche générationnelle du rapport au métier des éducateurs spécialisés.
Dans un premier travail de recherche, nous nous sommes intéressés au processus de transformation identitaire d’éducateurs spécialisés travaillant dans le secteur de la protection de l’enfance. Il nous a permis d’identifier des tendances fortes relatives aux transformations en cours dans le rapport au métier qu’entretenaient trois générations distinctes d’éducateurs spécialisés. A ce titre, nous avions envisagé l’analyse de récits professionnels selon une approche générationnelle. Voyons ce que nous disent ces catégories d’acteurs des évolutions à l’œuvre. Et surtout, tentons d’identifier quels pourraient être les analyseurs effectifs nous permettant de mieux comprendre les changements générationnels du rapport au travail des éducateurs spécialisés ?
Des générations aux enracinements professionnels distincts ?
Nous portons une attention toute particulière à l’analyse du contenu des récits professionnels. Ils témoignent de l’activité des acteurs, des imaginaires des sujets au travail. L’analyse des récits professionnels, que nous avons opérée des « anciens » éducateurs, témoigne de l’importance qu’occupent le vécu, l’expérience et les racines familiales dans leur « détermination » professionnelle. Émaillés d’épreuves, pour certaines traumatiques, les parcours de ces éducateurs issus, pour la plupart de milieux ouvriers populaires, traduisent des épisodes de ruptures relationnelles :
« Je suis issue d’une famille de mineur de fond »,
« J’ai perdu mon père à l’âge de 2 ans, élevé avec ma mère jusqu’à 14 ans »,
A ce titre, nous identifions le fait que l’engagement dans la carrière professionnelle résonne très nettement avec des épisodes personnels de profond mal-être :
« J’ai passé presque toute ma scolarité dans le fond de la classe avec des gens qu’on ne pouvait pas mettre ailleurs… »,
« Arrivée à l’école en 62, en plein pendant la guerre d’Algérie, pas de bons souvenirs, car c’était un moment de tension important où les algériens étaient mal vus, je ne comprenais pas pourquoi, je ne me sentais pas algérienne, et j’ai compris après »,
« Ma mère et mon père étaient violents, elle m’a défoncé une fois la tête avec une cocotte-minute parce que j’avais envie de manger ».
L’évocation des racines historiques et familiales, comme facteurs clairement énoncés servants de point d’appui à l’entrée dans la carrière de travailleur social, traduit, bien souvent, des tentatives de réparations, une sorte de processus résilient :
« J’étais rebelle, je faisais les 400 coups, je fuguais, on me ramenait, je recommençais, je me planquais, j’étais Robin des bois, je volais au riche et redonnais au pauvre… Zorro. J’aimais me mettre dans des personnages un peu… de sauveurs ».
Cette première analyse des trajectoires biographiques des « anciens » nous a permis de mieux comprendre en quoi l’histoire de ces acteurs, leur engagement professionnel et les valeurs dont ils se réclament, s’appuie sur ce que Max Weber appelait une éthique de la conviction ; une éthique où il s’agit, avant tout, d’agir en conformité avec ses principes et valeurs. Les « anciens » se présentent à nous comme des « croyants » qui puisent dans leur histoire les raisons de leur engagement.
Une conception de carrière renouvelée ?
En contre point, notre rencontre avec des éducateurs nouvellement formés, nous a permis de constater un effet de « tassement » concernant l’évocation expérientielle et familiale dans le choix de carrière professionnelle. Auparavant les éducateurs décidaient de leur orientation en fonction de principes et valeurs spécifiques étroitement liés à leurs activités militantes, politiques et idéologiques :
« Le milieu ouvert et le non mandat, la libre adhésion me plaisaient énormément, c’est ce que qui a fait basculer mon choix pour la protection sociale. Ne pas avoir d’étiquette, de ne pas représenter la loi quand le juge te désigne auprès d’une famille »,
A l’heure actuelle, il apparaît que ce sont davantage les opportunités professionnelles et la logique du marché du travail qui paraissent déterminer l’entrée dans la carrière éducative :
« Je suis arrivé en protection de l’enfance un peu par hasard, une annonce et hop, je postule », « Pour moi ce n’est pas une vocation »,
« Je me suis orienté en fonction du marché du travail ».
Fraîchement sortis du système scolaire organisé par l’éducation nationale, les « jeunes » éducateurs semblent se « cranter » plus aisément avec les nouveaux modèles managériaux, les logiques de projets, la « novlangue médico-sociale »… A ce titre, les mots employés changent et traduisent des ajustements identitaires professionnels majeurs.
Une sémantique « modernisée ».
Les mots sont importants, nous ne les utilisons jamais par le plus grand des hasards. Nous les choisissons, nous les associons pour qu’ils dégagent une signification. S’attarder sur le sens des mots est primordial car « Il faut des mots non seulement pour dire les choses mais aussi pour les faire. Ce sont les mots qui font une pratique… »1 (Gaberan P., 2009).
Éloignés du langage « baby-boomers » à dominante marxiste des anciens, les jeunes professionnels ont davantage recours à un vocabulaire « postmodernisé », fortement emprunté à une sorte de « langue médico-sociale », « une novlangue éthico-managériale »2 (Batifoulier F., 2011) qui s’articule autour de concepts très largement diffusés dans le secteur médico-social. C’est la langue qui « colonise » le langage courant et « les instances décisionnelles, évènements, colloques, presse spécialisée, réunions internes (…) Ainsi les termes de « clinique », « écoute » et « relation d’aide », sont peu à peu éliminés des contenus au profit de termes envahissant comme « pilotage », « évaluation », « engagement qualité », « management », « indicateurs », « résultat », « performance », « orientations stratégiques » » 3 (Chauvière M., 2007).
Pour autant, les jeunes générations d’éducateurs ne sont pas dupes en ce qui concerne la libéralisation du social. Pour preuve, elles refusent massivement de s’engager aveuglément dans les pas de leurs pairs. A ce titre, les plus jeunes professionnels se sentent les derniers occupants précaires d’un bail professionnel dont les murs se lézardent au fil des renoncements politiques et institutionnels successifs. Témoins du lent passage d’un traitement social de la question sociale à un traitement économique de la question sociale, ils renoncent à la quête identitaire de soi de leurs aînés pour qui, l’activité professionnelle servait à la réalisation de l’idéal du moi.
De ces changements sémantiques, idéologiques et politiques émergent alors bon nombre de décalages identitaires, des relations professionnelles collaboratives complexes, des télescopages générationnels majeurs. Ces décalages entre générations traduisent certes des désaccords d’intentionnalités, des visions du monde distinctes, ils sont aussi les témoins des transformations à l’œuvre dans les processus de professionnalisation. Nous nous attarderons, dans un prochain article, à cerner le regard que portent les « jeunes générations » à l’encontre de leurs pairs et verrons de quelle manière elles envisagent, à leur façon, leur rapport au travail, aux autres et à eux-mêmes… (à suivre).
Références bibliographiques / Sources :
1 Gaberan P., Cent mots pour être éducateur, Eres, 2009.
2 Batifoulier F. (dir), Manuel de direction en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2011.
3 Chauvière M., Trop de gestion tue le social, Essai sur une discrète chalandisation, La Découverte, 2007.
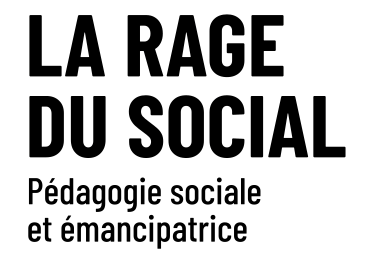
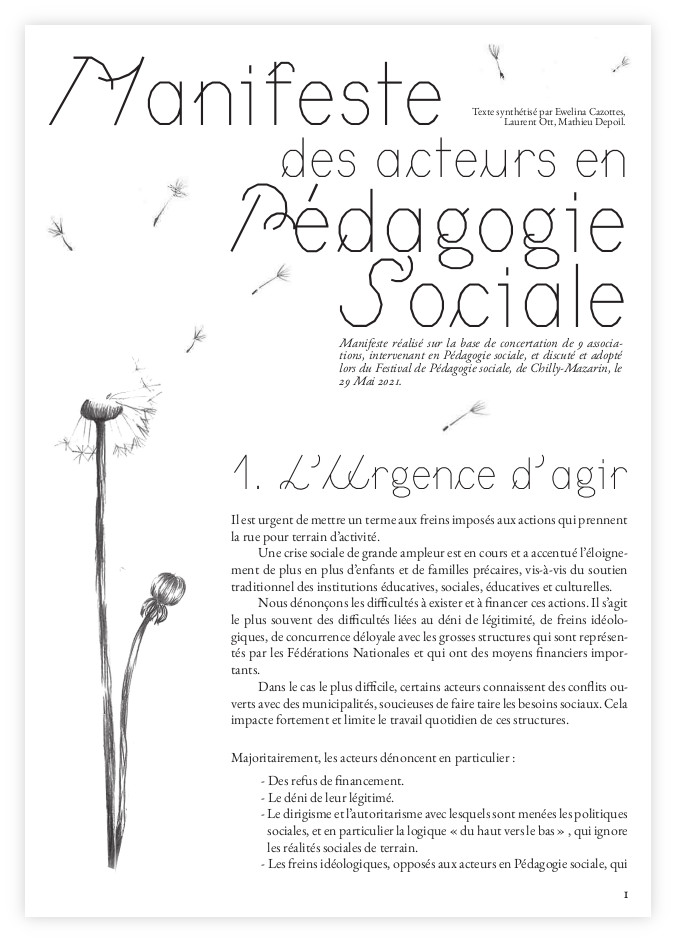
Laisser un commentaire