Par Pierre Dugué
Voici maintenant plusieurs années que notre centre de formation en travail social s’est invité dans un quartier que la puissance publique qualifie de « prioritaire », en « Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville ». Nous y formons des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux issus du bassin minier (Nord-Pas-de-Calais, 62), dans un territoire qui a vécu des transformations sociales et économiques majeures au sortir de la fin des années 70. La fin de l’activité minière, la crise économique, les fermetures d’usines successives ont laissé des traces indélébiles. Aussi, notre implantation dans un quartier populaire n’est pas le fruit du hasard, c’est un choix politique, stratégique, pédagogique. Et cela fait maintenant 10 ans que nous y formons des travailleurs sociaux.
J’emploie volontairement le nous, non par coutume et tradition de distanciation universitaire, mais parce que ce nous possède un sens. Comme nous avons coutume de le dire, stagiaires, formateurs, travailleurs sociaux, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes accueillis, invités dans ce lieu par celles et ceux qui y vivent. On ne s’implante pas sur un quartier.
L’apprentissage en contexte
Notre centre de formation en travail social est abrité dans une ancienne école primaire, une école dans un quartier populaire qui porte le nom de Nelson Mandela, au sein du quartier de la « République ». Quoi de plus beau que d’être abrité ici. Le centre de formation est souvent qualifié d’expérimental, il est pour nous davantage un espace d’expérimentation où la·les pédagogie·s sont centrales, premières. Les étudiants éducateurs travaillent, coopèrent, avec les habitants du quartier, des groupes d’enfants, des mères, des pères, des amis… chacun a sa place, rien n’est déterminé par avance.
Dans la cour du centre de formation, il y a aussi des carrés potagers où chacun peut s’essayer à l’apprentissage des pédagogies actives, et notamment à la pédagogie sociale. A ce titre, nous avons architecturé le ruban pédagogique de formation des travailleurs sociaux en nous agrippant aux méthodes actives. Nous partons du principe que l’on apprend en faisant, en tâtonnant, par le truchement de l’essai/erreur.
Ce lieu, car il est devenu depuis peu un tiers lieu, cherche à créer les conditions des apprentissages professionnels, il ne se réclame pas de l’éducation populaire, il s’adresse à tous, ici et maintenant, il est davantage positionné sur l’axiologie de la pédagogie sociale, chère à notre ami Laurent Ott et à son père fondateur, Janus Korczak.
Formateurs, étudiants, stagiaires expérimentent ensemble, se forment l’un avec l’autre dans la perspective de la création d’alliances éducatives et sociales qui font tant défaut au social libéralisé ; ce social qui considère que l’appellation « usager » n’est pas une métaphore… Nous y apprenons le côte-à-côte, l’aller vers, l’inconditionnalité, la pédagogie de l’auteur, la proximité d’avec l’autre car nous rejetons l’idée d’un social désincarné, qui respecterait « une bonne distance », une juste distance.
Pour nous, le couplage théorique et pratique de la pédagogie Freire et de la pédagogie sociale repousse les freins socio-psychiques des cadres institutionnalisant, en libérant les énergies réprimées par les modèles glorifiant les organisations sociales au détriment des institutions sociales.
Partir de soi…
En ce sens, cet espace favorise l’acquisition d’une place, l’horizontalité, la délibération, le conflit créatif, le débat… On y apprend surtout en partant de soi, de là où chacun est, de sa propre histoire, de son éducation, de ses liens d’appartenances en considérant le fait que l’étudiant est avant tout un sujet social singulier désirant qui agit en contexte.
On commence par soi, car tout commence par soi, pour reprendre Janus Korczak : « Commence par toi ! Sois toi-même, cherche ta propre voie. Apprends à te connaître avant de prétendre connaître les enfants. Mesure les limites de tes capacités avant de fixer celle des droits et des devoirs des enfants. Vis-à-vis de tous ceux que tu pourrais avoir à comprendre, élever, instruire, tu es arrivé avant eux : c’est donc par toi qu’il faut commencer ».1 (Korczak, J. 1978)
L’acte éducatif est un acte qui engage, il nécessite une pédagogie. Et comme Paulo Freire, aucune pédagogie n’est neutre. Elle est soit une arme de domestication, voire de déshumanisation, soit un outil d’émancipation. Notre approche pédagogique repose sur la compréhension des situations problèmes et sur la capacité de l’étudiant à coconstruire des réponses avec les premiers concernés en acceptant la conflictualité créatrice2 (Pagès M. 2006).
L’apprentissage de la formation repose pour grande part sur l’action recherche, sur l’idée qu’un objet de formation peut être abordé sous l’angle de la découverte, du tâtonnement, et non sous l’angle premier de l’apport théorique, frontal, descendant.
Aussi, il s’agit d’apprendre à entreprendre, systématiquement par l’action collective, notamment en mobilisant la concertation et la coopération avec des acteurs du territoire. Dans cette perspective, un groupe d’étudiants de première année a initié une maraude sociale sur trois villes. Le dernier jeudi de chaque mois, étudiants, bénévoles, habitants vont à la rencontre des plus précaires, au sein de quartiers populaires. D’autres organisent une journée de troc, des ateliers de jardinage, une cantine sociale va bientôt voir le jour. Chacun y découvre des mondes inconnus, les praticiens se confondent, les statuts s’amenuisent. Il est surtout question d’agir ensemble, de construire des réponses que certaines politiques publiques correctives peinent à juguler. Il s’agit aussi de retrouver du pouvoir à agir sur le quotidien, ici et maintenant.
… pour aller vers l’autre.
Pour nous, la formation et l’apprentissage ne se limitent pas aux espaces dédiés au terrain de stage, le centre de formation est lui aussi un lieu de découverte de soi et des autres, il unit et favorise l’évitement des approches individualisantes pour tendre à la création d’un espace de délibération favorisant l’exercice de la citoyenneté. Ici, il est peu question d’acquisition de compétences, hormis pour entrer dans les cadres normalisant des certifications professionnelles, il est davantage mis l’accent sur la stimulation et l’activation des appétences collectives. Ces expériences sociales servent à prendre conscience des rapports sociaux, des rapports de domination pour mieux appréhender l’exercice du métier de travailleur social.
Nous nous appuyons sur l’instant sans mépriser l’histoire car l’éducateur en formation est avant tout histoire, il est agi par cette dernière tout autant qu’il possède la possibilité d’agir sur elle. Et il nous importe de mettre la petite et la grande Histoire en perspective dans le processus de professionnalisation de chacun. Ce mouvement biographique, itératif, facilite la compréhension des déterminants sociaux qui agissent chacun et chacune ; non pas dans le souci unique de les débusquer, et d’en démasquer les méfaits, mais surtout dans la perspective de défier leur soutenabilité dans les trajectoires personnelles et familiales des apprenants, de faciliter l’élucidation des mécanismes d’incorporation des assignations de classes, des pensées réprimées…
Ce détour par soi repose sur l’idée que l’acte éducatif est avant tout un acte sensible, il passe par le sujet car c’est lui qui en donnera corps, chaire et âme. Il s’agit ici de trouver ce qui lie, ce qui relie pour ensuite envisager de s’allier. L’acte éducatif suppose en effet des alliances collaboratives qui favorisent la production d’un réel bâti en commun. Comme le souligne Philippe Meirieu, point « d’éducatif sans praxis »3 (1996). Les éducateurs spécialisés que nous accompagnons font sans cesse l’épreuve d’eux-mêmes parce qu’ils ne peuvent faire l’économie du conflit psychique dans l’acte éducatif.
Notre approche se mêle aussi à la sociologie clinique, qui est soucieuse de considérer les interrelations entre les questions sociales et la part psychologique, subjective, agissant l’individu. Pour nous, apprendre les métiers à l’adresse d’autrui nécessite d’accompagner les professionnels à la prise de conscience d’un « soi social » assumé. Il s’agit à la fois de se former, tout en considérant ce qui a participé à la formation de l’acteur, du sujet, pour lui permettre de devenir auteur. L’étudiant est fruit d’un parcours biographique qui, mis en perspective sociale, peut être au service d’une compréhension et d’une émancipation du sujet vis-à-vis de l’histoire officielle qu’il a incorporée au gré de ses expériences de socialisation antérieures.
Le travail social a été redéfinit dans ses modalités de professionnalisation, et nous assistons, à l’heure actuelle, à une véritable mutation de la socialisation des professionnels du travail social. Auparavant, les travailleurs sociaux considéraient leur activité comme étant désintéressée, vocationnelle, bâtie sur des croyances, le don de soi, sacralisant ainsi une forme singulière d’action. Aujourd’hui, le travail social est jugé selon ses performances et sa capacité à juguler les désordres générés par la diffusion de l’insécurité sociale. A ce titre, bon nombre de prescriptions implicites faites aux organismes de formation renforcent l’idée qu’ils doivent être au service du processus d’adaptation du travail social modernisé, chalandisé. Dans le même temps, on entend souvent dire que les référentiels de formations brident les élans créatifs des « organismes » de formation. Nous y adhérons pour partie mais ne pouvons nous résigner à cet état. Nous croyons surtout que les petits renoncements ont à voir avec l’essor des individualismes exacerbés, et considérons, pour plagier Paulo Freire, que « personne ne libère personne, personne ne se libère tout seul : les hommes se libèrent en communion. »4 (Freire P., 2005).
Références Bibliographiques / Sources :
1 Korczak P., Comment aimer un enfant, Paris, Robert Laffont. 1978
2 Pagès M., L’implication dans les sciences humaines. Une clinique de la complexité, Paris, L’Harmattan, 2006.
3 Meirieu P., Frankenstein pédagogue, Paris, ESF éditeur, 1996
4 Freire P., Pédagogie des Opprimés, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2005
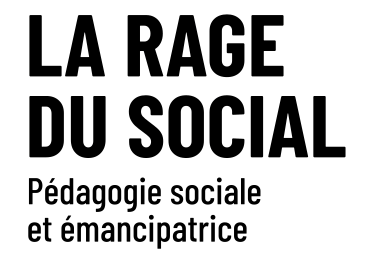
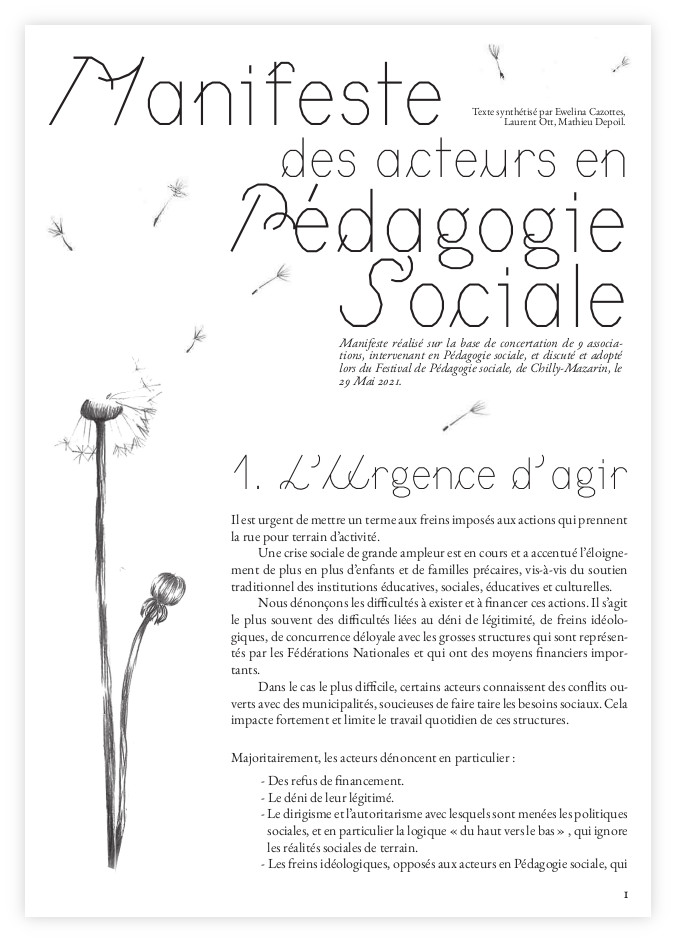
Laisser un commentaire