Par Gabriel Ott
Précédemment, j’ai évoqué l’importance de mieux redéfinir les nombreuses spécificités d’un atelier de rue. Même si le risque d’un tel guide serait de « muséifier » à long terme la pratique. Ainsi, je ne saurais trop conseiller aux praticiens de ne pas laisser trop longtemps les concepts et les outils dans le formol. Cependant, il existe des spécificités propres à l’atelier de rue, tel qu’il est pratiqué par un certain nombre d’associations de pédagogie sociale.
L’atelier de rue est l’objet privilégié de la Pédagogie sociale. Les ateliers de rue, mis en place, doivent avoir une constitution similaire. On retrouve un ensemble de rituels pédagogiques, utiles à la structuration de ceux-ci. Que ce soit par le choix des espaces, le matériel emporté, dans les différents temps qui les composent ou encore les différents rôles et tâches que les enfants sont amenés à endosser.
- Les différentes nattes de l’atelier de rue
Dans le cadre de l’atelier de rue, l’objet essentiel est la natte (tapis de sol). La table réduit toujours la fréquentation de l’activité au nombre de chaises disponible. La table restreint la capacité de partir, revenir, bouger et changer de place. C’est une règle tacite induite par l’école. La natte est un objet plus ouvert, qui permet le déplacement d’activités en activités.
De plus, lors des ateliers de rue qui mélangent les enfants de toute tranche d’âge, la table devient un objet restrictif et gênant. Un enfant de 11 ans ne pourra pas jouer au même jeu de société qu’un enfant de 6 ans sur une table, en raison de l’écart de taille. Les nattes en plastique comportent d’autres intérêts d’un point de vue pratique. Elles sont légères et faciles à transporter, et elles sont faciles à laver. Il est important que les nattes soient lavées avant chaque atelier, le public ne voudra pas s’asseoir dessus si elles sont sales ou sentent mauvais. Il ne faut surtout pas hésiter à les jeter, ou à les remplacer. C’est l’élément central des ateliers de rue.
La natte petite enfance et jeux symboliques
Se compose d’un certain nombre d’objets :
a) Les jeux de motricité qui s’adressent aux enfants les plus jeunes. On retrouve dans cette catégorie les hochets, certaines peluches, cubes, imagiers, mais aussi des puzzles avec peu de pièces.
b) Les jeux de construction/les jeux de motricité fine (gros LEGO, KAPLA) qui ne s’adressent pas uniquement à la petite enfance. En plus de la motricité, l’enfant y travaille aussi sa créativité.
c) Les jeux symboliques, chers à la Pédagogie nouvelle. Dans cette catégorie de jeux on retrouve la dînette, les poupées, la panoplie de médecins, certains lots de petits instruments de musique. Généralement, on commence à avoir des enfants entre 2 et 3 ans sur les tapis de sol.
La natte dédiée à la lecture
C’est une natte compliquée à faire vivre sans référents. Il est bien d’y être présent pour servir d’intermédiaire entre le livre et l’enfant (tourner les pages, faire les jeux ensemble, lire une histoire). Une natte lecture efficace comporte peu de livres, qui se définissent en plusieurs catégories.
Les indispensables :
a) Les « livres objets ». Les livres à illustrations, les livres « pop-up ».
b) Les livres Jeux. Du type « Où est Charlie » (il en existe d’autres). Les livres jeux, comme les livres objets, sont ceux qui peuvent rendre la caisse lecture attractive, ils sont une première étape vers d’autres livres.
c) Histoires courtes illustrées. À lire à voix haute.
Il existe d’autres types de livres pouvant être présents sur l’atelier :
d) Les encyclopédies illustrées. L’apprentissage pédagogique peut parfois prendre des chemins bien étranges. Il se pourrait que les enfants, même ceux ne sachant pas lire, puissent acquérir des apprentissages, à travers les images des encyclopédies. Bien souvent, ces livres servent de jeu symbolique, pour jouer à étudier ou au bibliothécaire.
e) Les bandes dessinées. Souvent, elles ne rencontrent pas le même succès que les histoires illustrées. Peut-être parce qu’elles s’adressent à des enfants plus âgés, malheureusement moins attirés par les livres.
Le roman jeunesse est quant à lui inutile dans le cadre d’un atelier de rue. L’enfant n’arrivera pas à trouver la concentration pour le lire.
La natte jeux de société
Le jeu de société fait débat ; tous n’y voient pas un intérêt pédagogique. Mais il me semble que certains jeux de sociétés aident au développement du langage (Ni oui, ni non, le Dixit, le Devine têtes, le Dobble). Les grands jeux de plateau, avec trop de pièces et des règles longues à comprendre, sont malheureusement inutiles sur un atelier de rue. - Les activités
Les activités artistiques ont une place essentielle au sein de la pédagogie sociale. Elles aident au développement de l’estime et, par extension, renforcent l’envie d’apprentissage.
Les activités cuisine rentrent elles aussi dans le cadre des activités créatives. Faire de la cuisine, en pleine rue, n’est pas si compliqué que ce que l’on pourrait croire. Avec un four roquette, (mini four à feu que l’on peut transporter) il est possible de faire cuire des gâteaux, faire revenir à la poêle. Il est possible de tout faire – la seule limite étant le temps de l’atelier. L’idée étant bien entendu de manger ce qui a été préparé au moment du goûter. Pour ces ateliers cuisine, il est bien évidemment important de veiller au lavage des mains, et de ramener le nécessaire : savon et jerrican d’eau.
Les activités sportives peuvent fonctionner dans le cadre de partenariats avec des associations présentes sur le territoire. Il me semble qu’une place particulière doit être accordée à la danse, qui permet à la fois de travailler sur la créativité tout en aidant à valoriser une image de soi positive. - Les différents temps de l’atelier de rue
– L’installation des nattes
– Temps d’activités
– Rangement (lors du rangement, l’enfant doit être acteur)
– L’histoire (l’histoire idéale pour ce temps doit faire moins de 10 min)
– Le goûter (il est servi par les enfants et parfois même préparé par les enfants)
– Le temps du conseil des présents (il s’agit d’un temps de liberté d’expression pour l’enfant, il peut parler de ce qu’il voudrait faire, de ce qu’il a fait pendant l’atelier et de ce qui s’est passé dans sa semaine. Il peut s’agir d’un moment difficile pour l’enfant qui n’arrive pas forcément à s’exprimer en public. Mais cet apprentissage est important.).
Les différents rôles tenus par les enfants, lors des ateliers :
– Le rangement. Tous les enfants doivent participer au rangement. On peut aussi rajouter à ce temps de rangement le temps du lavage des pinceaux, gobelets, nattes.
– Le musicien. Lors du moment de l’histoire, un enfant se voit confier un Kalimba ; son rôle est d’accompagner l’histoire.
– La préparation et la distribution du goûter. Pour pouvoir prendre ensemble le goûter, enfants et adultes sont assis en cercle sur les nattes. Seuls les enfants « responsables goûter » peuvent se lever pour distribuer. Les enfants « responsables goûter » portent un collier de perles pour pouvoir réaliser cette fonction.
– Le Maître de conseil. Pendant le temps du conseil des enfants, tous les enfants sont assis en cercle. Le maître du conseil est le seul qui puisse se lever. Il commence le conseil par la phrase suivante : « je déclare le conseil ouvert ». Il distribue la parole aux enfants qui lèvent la main. L’objet symbolisant le droit de parole est une marionnette qui permet à l’enfant de s’exprimer plus librement en passant par un intermédiaire. Quand plus aucun enfant ne réclame la marionnette pour parler, le maître du conseil termine l’assemblée par la phrase suivante : « Je déclare le conseil fermé ».
– Le secrétaire. Se voit confier « le Cahier du conseil » et un stylo ; son rôle est d’écrire ce qui se dit lors du Conseil.
– Le Maître du temps (optionnel). Si la durée du conseil s’étire en longueur. Il est possible de mettre en place un « Maître du temps », qui se voit confier une grande horloge, pour s’assurer que le conseil ne dépasse pas 10 min. Une fois ce temps atteint, il fait signe au Maître du conseil qui clôt le conseil.
Ainsi s’achève selon moi la composition d’un atelier de rue « idéal ».
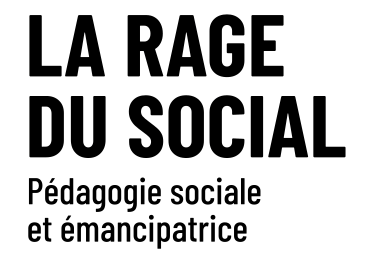
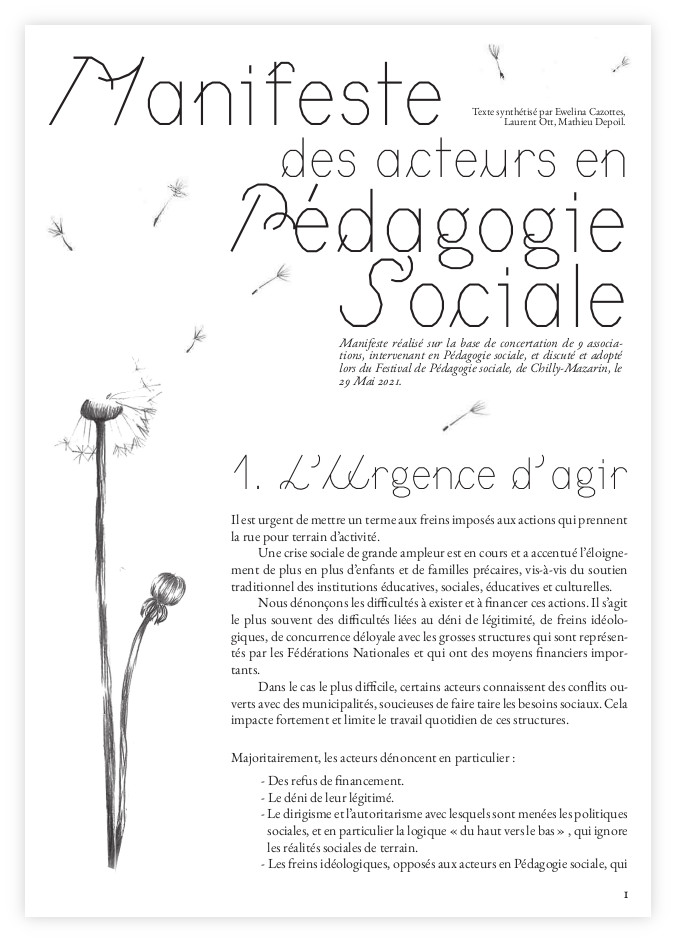
Laisser un commentaire