Par Gabriel Ott
De plus en plus, les centres sociaux sortent de leurs murs. Le terme « d’aller vers » se répand dans le langage courant du travailleur social. Que signifie ce changement ? Est-ce vraiment une nouvelle conception du travail social ? Ce travail est-il compatible ou même similaire à celui effectué dans le domaine de la pédagogie sociale ? Est-ce un point de rencontre ; ou alors ce changement ne rend-il pas visible la dissension opérée par la pédagogie sociale ?
L’objectif de l’atelier socio-éducatif en milieu ouvert est d’aller directement à la rencontre des familles, en s’installant en bas des habitations du public concerné par les activités. Bien souvent, les places investies lors d’un atelier de rue sont déjà des lieux de vie. Certains parents s’y rencontrent autour d’un café. Si la place contient une fontaine d’eau, des mères de famille sortent pour laver leurs tapis. Dans ces espaces de vie, les adultes ne sont pas forcément les plus présents. Certains enfants investissent plus encore ces espaces que leur propre domicile. Ceux-ci peuvent être dehors des journées entières le week-end (parfois sans prendre de repas le midi). Bien souvent, leurs capacités de déplacement se restreignent uniquement au bas de la fenêtre de leurs appartements, afin que les parents puissent garder une visibilité. Si bien que la seule manière d’aller à la rencontre de ce public soit de se rendre directement en bas des habitations.
Les enfants occupent principalement ces espaces publics où se déroulent nos interventions. Le choix de l’espace est important pour la réalisation d’un atelier de rue, efficient. L’atelier de rue doit se dérouler dans l’espace même où se trouve le public recherché. Les espaces verts au pied des immeubles sont généralement des emplacements idéals, il en existe d’autres : place centrale d’un bidonville ou d’un squat, parking d’hôtels sociaux. Il est plus rare de voir des enfants (en dessous d’un certain âge) seuls se baladant en centre-ville. Ainsi, tous les espaces d’interventions ne se valent pas pour un travail de pédagogie sociale. C’est le choix des espaces d’interventions qui distingue le travail de la pédagogie sociale des nombreuses tentatives de travail in-situ proposées par les centres sociaux, et les mairies. Les activités extérieures, estivales proposées par ceux-ci, sont bien souvent effectuées dans des parcs en centre-ville, et de préférence proches de la mairie, chose qui n’apporte pas de réelles solutions aux difficultés de déplacements rencontrées par les familles précaires. Ces activités finissent inéluctablement par se dérouler hors de portée des enfants et adolescents les plus en demande d’activités ; malgré la gratuité bien intentionnée de celles-ci.
Les places possédant du mobilier urbain, type bancs, aires de jeux, fontaines d’eau potable, renforcent l’ancrage de l’atelier de rue. Les deux premiers aidant au rassemblement d’adultes et d’enfants, le troisième aidant à la cuisine et à la préparation de goûters. Si cet espace d’accueil en milieu ouvert n’est pas optimal, l’atelier de rue peut prendre pour objectif l’amélioration de celui-ci : création de bacs à plantation pour des herbes aromatiques, création d’un jardin, de décorations, de dazibaos, etc.… L’atelier de rue tend à la transformation de l’espace où celui-ci se déroule. C’est cette volonté de créer de façon durable qui distingue l’atelier de rue d’autres formes d’animations in-situ.
Cette volonté de laisser une trace sur les lieux d’interventions est renforcée par la ponctualité des actions. C’est dans cette ponctualité que l’on constate l’impact pédagogique de l’atelier de rue ; où il est possible de voir l’évolution de notre public sur plusieurs années. Dans le cadre d’ateliers de rue menés à long terme, j’ai pu constater chez certains enfants des améliorations dans l’apprentissage du français, une plus grande aisance du langage et plus de facilités dans l’expression plastique. Y compris chez des enfants déscolarisés ou ayant eu une scolarité perturbée par un grand nombre d’expulsions successives.
C’est dans ce choix de transformation du milieu et de la régularité, que l’on constate une distinction fondamentale entre la pratique de la pédagogie sociale et celle des centres sociaux proposant des « allers vers ». Ce travail « d’aller vers » (terme de plus en plus utilisé) définit en réalité une ambition et des finalités différentes, de ceux de la pédagogie sociale. Ceux-ci vont vers le public pour le ramener en leurs murs. Il semble toujours aussi compliqué à l’heure actuelle de défendre un travail en milieu ouvert permanent. Il est peut-être même plus difficile de proposer cette chose spécifique qu’est un atelier de rue, à une époque où tous prétendent faire de même. Ces institutions adeptes du « aller vers » ne comprennent pas toujours l’utilité d’intervenir sur des lieux fixes à des horaires fixes, de façon hebdomadaire, et pour ce qui est d’intervenir dehors en automne ou en hiver, aucune de celle-ci n’ose l’aventure.
Il me semble important désormais, en pédagogie sociale, de mieux définir les nombreuses spécificités d’un atelier de rue. Il faudrait un guide énumérant concrètement les différents outils de la pédagogie sociale, les différents temps d’un atelier de rue ainsi que différentes méthodes, pour mener à bien les instants de vie qui composent celui-ci.
Le travailleur social n’arrive toujours pas à se débarrasser des murs qui l’entravent. Il n’arrive toujours pas à se défaire d’un schéma le poussant à considérer d’un intérêt moindre ce qu’il organise dehors, et d’une importance supérieure ce qui se passe dans l’enceinte de ses locaux, même si ceux-ci sont vides !
Le déroulement en milieu ouvert des ateliers de rue ne réduit aucunement la portée sociale et pédagogique de ceux-ci. Même si cela produit à l’oreille de l’entendeur un oxymore : « accueillir en milieu ouvert ». Il semble difficile de recevoir une personne à l’extérieur d’un lieu créé pour recevoir, car l’idée de réception repose sur l’idée qu’une personne extérieure vient dans un lieu de vie où on est soi-même propriétaire ou utilisateur. En ce sens, il semble difficile de recevoir dehors, car on n’est aucunement propriétaire de l’espace public. Cependant, on peut être utilisateur de l’espace public, il faudrait passer d’une conception d’espace public appartenant à personne à une conception de l’espace public comme appartenant à tous. Si l’espace public appartient à tous plutôt qu’à personne, il semble moins étrange de l’occuper, d’y vagabonder, et même d’y recevoir du monde (quand l’on s’estime en bon droit comme utilisateur de l’espace public). Il semble après ceci moins étrange d’accueillir dehors, encore nous reste-t-il à définir ce qui fait la qualité de cet accueil une fois les murs retirés. Même s’il ne semble pas possible d’héberger dehors, il est cependant possible de réaliser un ensemble d’actions liées à l’accueil : organiser des repas, cuisiner, offrir une certaine qualité d’écoute, aider à l’apprentissage. Le chemin est encore long, et notre travail toujours autant d’actualité, reste ancré dans le réel !
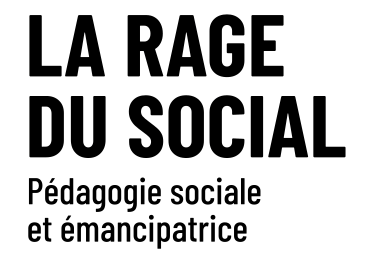
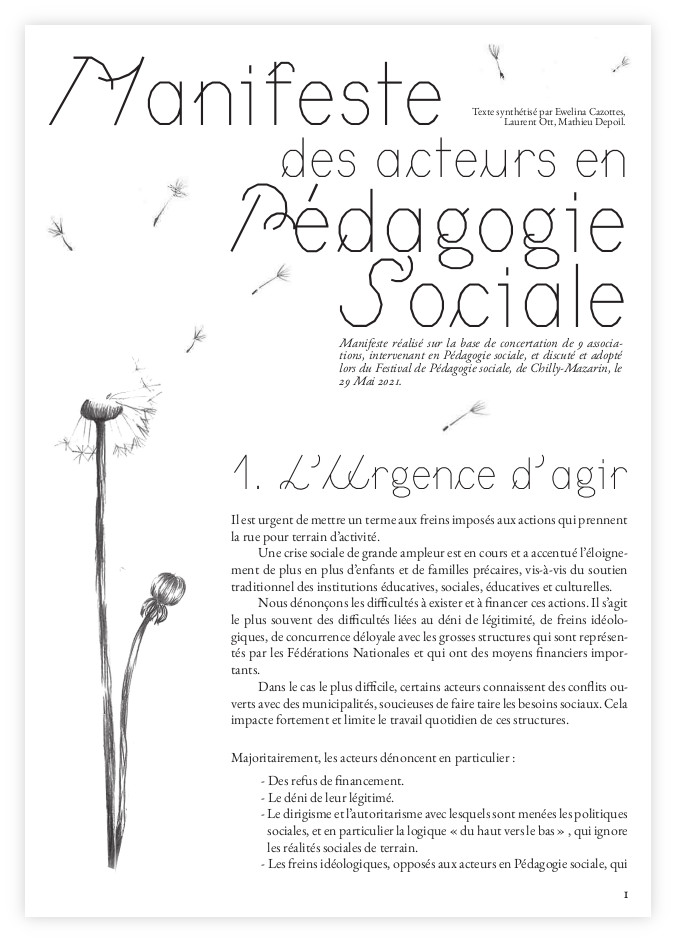
Laisser un commentaire