Par Mathieu Depoil
Depuis une quinzaine d’années, la notion de « pouvoir d’agir » – traduction francophone du concept d’empowerment – inspire de nombreuses organisations et structures du travail social et de l’éducation populaire. Apparu dans un contexte de lutte sociale aux États-Unis dans les années 70, celui-ci semble aujourd’hui rattrapé et détourné de son objet initial par l’esprit néolibéral, conférant ainsi à ce concept non plus une visée d’émancipation collective et de transformation sociale mais plutôt un encouragement à « l’épanouissement personnel » et à une « contribution citoyenne et symbolique » aux instances démocratiques procédurales. Cette réorientation semble ainsi légitimer, par le fait, une politique d’individualisation des rapports sociaux et de technocratisation de la vie démocratique. Alors, quelles seraient les limites à percevoir au « pouvoir d’agir », tel qu’il est « entrepris », dans notre contexte politique ? Quelles seraient les éventuelles dérives et ambivalences de ce concept, pourtant construit et imaginé autour d’un besoin pressant de justice sociale ?
« Quand on veut, on peut ! », « On a la vie qu’on se donne ! », « Il suffit de le vouloir… », etc. A l’image d’une société où l’individualisme et l’effort personnel constituent le socle primaire des relations au monde, ces expressions régulièrement entendues dans la vie ordinaire et médiatique, traduisent une certaine vision politique que nous pourrions facilement qualifier de néolibérale. Vision centrée sur la capacité seule de l’individu à se surpasser, à quitter sa condition pour s’accomplir, à s’adapter et procéder à sa propre transformation individuelle pour atteindre son but, nécessitant courage, détermination et autosuffisance – être entrepreneur de sa propre personne –, démarche dans laquelle nous ne trouverons aucun égard ni écho à un collectif de personnes ou à une communauté inspirante et protectrice,… Mais les choses sont-elles si simples ? Quid des autres personnes composant le milieu ? Qu’adviendra-t-il du reste de la société ? Des précaires, des exclu·e·s, des dominé·e·s, des opprimé·e·s ? De celles et ceux qui n’ont pas les moyens du courage, de la détermination et de l’autosuffisance ?
Nous analysons que dans notre contexte socio-économique en tension, le néolibéralisme instrumentalise le « pouvoir d’agir » dans le but d’offrir un semblant de solution aux difficultés des plus précaires, inventant ainsi de toute pièce le pendant illusoire et social du « pouvoir d’achat » : redonner économiquement l’illusion du pouvoir d’achat pour ne pas créer de révolte et redonner politiquement l’illusion du pouvoir d’agir pour ne pas initier de révolution. Cette illusion se construit dans une réponse par le bas, c’est-à-dire en donnant uniquement la possibilité aux personnes de se changer et se prendre en charge elles-mêmes, en les détournant des enjeux pouvant requestionner le système politico-économique dans lequel nous évoluons actuellement. Le pouvoir de décision n’est pas réellement donné sur les grandes questions démocratiques et sociétales, ce qui serait un pouvoir vers le haut. Pour les néolibéraux, la rupture avec le projet émancipateur du pouvoir d’agir se situe ici : entre l’organisation marchande de notre société, la fabrique du consentement de masse, et la vision minimaliste et procédurale de la démocratie1 (Stiegler – 2019). A nous, travailleurs et travailleuses du lien social de ne pas tomber dans le piège.
Ces politiques ayant déjà envahi le secteur de la santé (marché public, modèle tentant de l’utilisateur/payeur, marchandisation des soins, etc.) et de l’éducation (parcours sup’, division du travail éducatif, etc.), il n’y aurait aucune raison que le travail social et l’éducation populaire n’y échappent2 (Richez – 2016).
Avec cette forme de « pouvoir d’agir », le fait d’élaborer à des fins d’individualisation des rapports sociaux, de « responsabilisation », « de rationalisation » et « d’auto-prise en charge » des plus démuni·e·s3 (Bacqué, Biewener – 2015), le néolibéralisme et les acteurs qui s’en saisissent (souvent malgré eux), constituent une attaque contre le fondement pédagogique de nos métiers. Emmêlant les éducateurs et éducatrices dans une complexité technique et sémantique visant à transformer le pouvoir d’agir en terme-valise, l’idée principale serait surtout d’instaurer une légitimation citoyenne des orientations technocratiques et financières par une tentative d’humanisation des procédés justifiant un semblant de vie démocratique. Tout devient alors « Pouvoir d’Agir » : choisir son repas au self, c’est le pouvoir d’agir. Laisser les enfants choisir entre « activités manuelles » et « sport », c’est le pouvoir d’agir. Laisser les familles choisir la destination du week-end famille, c’est le pouvoir d’agir. On quitte les processus pédagogiques de l’émancipation pour se réfugier dans les méthodes dites « participatives » souvent réduites à la simple notion d’envie personnelle et de choix. La méthode dite active s’impose au détriment d’un processus critique.
Dans notre cas, le « pouvoir d’agir » émancipateur semble être menacé par plusieurs éléments propres au néolibéralisme et à la confusion qu’il alimente :
- l’approche individuelle du processus, détachée d’un objet de lutte collective pour un changement social : confondre le bien-être individuel (qui agit sur sa propre existence) avec la volonté de changement et de révolte personnelle (qui agit sur la cause de l’oppression collective). L’argument courant d’amorcer le processus de pouvoir d’agir par une démarche de développement personnel, sans privilégier les rapports sociaux, trouve des limites dans l’absence de miroir qu’offrent le monde et le collectif. L’émancipation ne peut être un voyage qui s’entreprend seul·e. Dans un souci de « pouvoir d’agir » à visée émancipatrice et non épanouissante, les activités à caractère individualisant sont-elles à pratiquer avec prudence ? La réponse serait probablement oui, suivant la visée politique du pédagogue. Irène Pereira, philosophe et sociologue, évoque ce principe en ces termes : « l’accent mis sur les compétences individuelles, sans référence à des rapports sociaux de pouvoir, favorise un glissement vers le capitalisme par projet. On peut ainsi parler d’une récupération de la critique artiste pédagogique – c’est-à-dire les pédagogies orientées vers le développement personnel – par le nouvel esprit du capitalisme »4. Ce premier écueil, influencé par le culte de l’individu propre à la vision libérale de la condition humaine, peut être un obstacle dans le développement du pouvoir d’agir émancipateur.
- L’innovation sociale, qui devient une fin en soi, s’oppose à la logique de processus au profit d’une logique de technique et de dispositif d’alliance entre l’état néolibéral et le secteur privé. Contrairement aux idées reçues, l’innovation n’est ni « invention » ni « découverte » mais une simple modification et amélioration de la fonction de production (Shumpeter – 1942)5. Ainsi rapportée aux sciences sociales et éducatives, l’innovation ne correspond pas à une démarche de recherche-action répondant à de nouveaux enjeux ou nouveaux besoins de la population mais contribue à améliorer les systèmes existants dans un souci d’efficience, d’efficacité et donc de rationalisation des coûts. Introduire de la nouveauté dans les pratiques et dans les projets, refaire ce qui a été fait sous une autre forme, « à nouveaux besoins, nouvelles innovations ! », sublimation de la novlangue managériale, etc., confondant alors « progrès » et « expérimentation ». Ici l’innovation peut être définie comme un prérequis et une injonction définissant à la fois les critères de contractualisation des financements publics mais également les modalités d’interventions, ouvrant « les vannes » à une mise en concurrence des acteurs et actrices par les appels à projets ou marchés publics. Le « pouvoir d’agir », de par sa nature plurielle et son caractère politique, pourrait être un prétexte à forcer l’innovation, notamment dans l’éducation populaire avec l’arrivée des « start-ups sociales », de l’entreprenariat et de la marchandisation des fonctions éducatives, symptômes modernes du néolibéralisme et du capitalisme d’activité 6 (Decamp – 2021).
- La « participation symbolique et institutionnelle » au détriment de la « lutte des classes et des rapports sociaux de domination » : la rupture démocratique. Par le biais de certains dispositifs institutionnels, la nature des relations politiques entre les « citoyen·ne·s » et leurs représentant·e·s est parfois technicisée et réduite à une participation et à une consultation sur des sujets préalablement ficelés et conduits par des technicien·ne·s, au détriment d’un rapport direct aux politiques. Ce type de protocole, inspiré de la vision limitée et néolibérale de la démocratie, peut être considéré comme « une injonction » à améliorer sa propre condition et non pour contribuer aux débats et à la construction des politiques publiques. Dans cette position, l’habitant est également considéré comme « incapable » de contribuer à l’intérêt général, il est donc naturellement orienté sur un parcours de formation civique afin d’être à la hauteur des enjeux politiques7 (Carrel – 2013). Cette approche exclut donc de fait les questions de transformation des institutions, de définition des enjeux prioritaires et de conscientisation des processus de fabrication d’inégalité, d’exclusion, de domination conduisant à entreprendre une lutte sociale et de classes.
Dans le cas de cette forme de participation, le « pouvoir d’agir » serait-il un outil de préservation du néolibéralisme ou un outil d’émancipation ? Cette dimension semble être une des ambivalences de ce concept et vient questionner en profondeur les pratiques de l’éducation populaire et de l’action sociale autour de cette notion.Face à cette illusion participative, les questions éducatives peuvent peut-être devenir un rempart, par la repolitisation des espaces et démarches pédagogiques d’une part et par l’effort de conscientisation et de décryptage des contextes politiques d’autre part : se tourner vers les pédagogies radicales, critiques et sociales pour repositionner le collectif et la question sociale au centre du processus d’éducation et d’émancipation.
Références bibliographiques / Sources :
1 Stiegler B., Il faut s’adapter. Sur un nouvel impératif politique, Paris, Gallimard, 2019.
2 Richez J.C. in Lebon F, et De Lescure E., L’Éducation populaire au tournant du XXIe siècle, Vulaines-sur-Seine, Édition du Croquant, 2016, p. 44
3 Bacqué M.H., et Biewener C., l’Empowerment, une pratique émancipatrice?, Paris, Éditions La Découverte, 2013.
4 Pereira I., « Les pédagogies critiques ou le refus de la confusion néolibérale en pédagogie », dans Frédéric Darbellay, Zoe Moody et Maude Louviot (dir.), l’École autrement. Les pédagogies alternatives en débat, Neuchâtel, Éditions Alphil-Presses universitaires suisses, 2021, p. 114.
5 Shumpeter J., Capitalisme, socialisme et démocratie, Éditions Payot, 1990
6 Decamp A., Éducation populaire : nouvel eldorado des Start Up Social, Éditions Libre & Solidaire, 2022
7 Carrel M., Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires. Lyon, ENS Éditions coll. « Gouvernement en question(s) », 2013
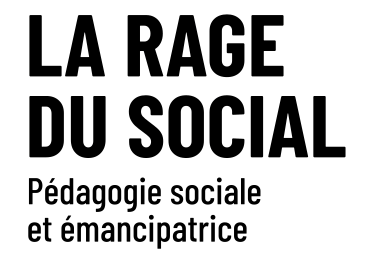
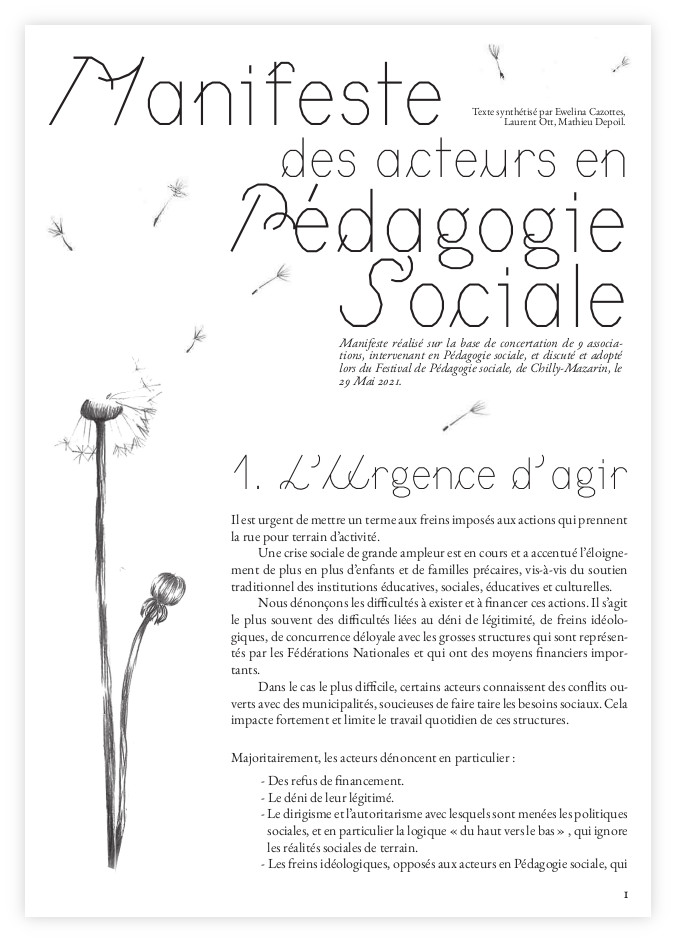
Laisser un commentaire