Par Gurvan Bricaud
Source : Cahiers de l’action : Des liens et des lieux : l’aller vers en pratiques – 2022/2/n° 59 INJEP
Membre fondateur de l’association Tous les Maquis1, implantée dans le Val-de-Marne, Gurvan Bricaud revient dans cet article sur différentes actions menées par l’association auprès des enfants et des familles dans différents espaces de vie. Se revendiquant d’une démarche de pédagogie sociale, le retour d’expérience opéré ici offre l’occasion d’appréhender concrètement les fondements méthodologiques et philosophiques de cette approche basée sur une logique de construction « chemin faisant » des projets et des activités développées avec les différents participants.
L’association Tous les Maquis trouve son origine en 2015, lorsque nous avons formé un collectif de cinq travailleurs et travailleuses issu·e·s de l’éducation populaire et du travail social (accueils collectifs de mineurs, éducation spécialisée, formation, etc.) et de militants syndicaux ou de mouvements pédagogiques. À cette époque, nous nous posions toutes et tous des questions, dans nos lieux de travail respectifs (collectivités territoriales, fédérations d’éducation populaire, associations, etc.) et dans un contexte d’urgence sociale et éducative, sur la possibilité d’exercer notre travail tel que nous l’envisagions.
Nous constations que de plus en plus d’enfants et leurs familles se trouvaient en situation de précarité. Nous l’observions, par exemple, au sein des accueils collectifs de mineurs, lorsque certains enfants qui n’avaient que le centre de loisirs comme activité extrascolaire ne pouvaient plus y venir faute de moyens financiers suffisants. Nous observions également dans le travail social des phénomènes de « gestion » de la misère, avec bien souvent des travailleurs sociaux empêchés, par manque de moyens, de faire leur travail. Les politiques institutionnelles mises en place (par l’État, l’école, les collectivités territoriales, les services sociaux, etc.) ne nous semblaient plus en capacité d’apporter de réponses satisfaisantes aux plus précaires.
La distance, le contrôle et la gestion, si ce n’est le jugement ou la suspicion, ne permettent pas une rencontre authentique, à égalité.
De même, les logiques de ciblage des publics, le plus souvent captifs, qui se mettent en place dans l’éducation populaire ou l’animation sociale pour répondre aux appels à projets, ne construisent que peu de liens durables. Au lieu d’être ensemble, on se retrouve côte à côte.
Nous avons alors décidé de créer notre propre outil de travail, l’association Tous les Maquis, avec l’ambition de réhabiliter les espaces publics, le dehors, la rue, la nature, comme des espaces sociaux et éducatifs à part entière. Nous avons ainsi progressivement mis en œuvre, avec des moyens modestes, notre projet associatif et éducatif : éduquer et animer dehors, dans la rue et dans la nature.
De 2015 à 2018, alors que l’ensemble du collectif était encore salarié hors de l’association, nous avons participé à plusieurs initiatives locales coorganisées par des associations et la ville de Champigny-sur-Marne comme le « printemps des familles2 » ou les « rues aux enfants, rue pour tous3 », lors desquelles une rue est fermée à la circulation et transformée en aire de jeux. À chaque fois, nous y avons contribué en organisant des ateliers éducatifs de rue ou des ateliers d’éducation populaire, toujours dehors, dans l’espace public.
En 2019, l’un des fondateurs de l’association a quitté son emploi salarié afin de se consacrer au développement de l’association, en lien étroit avec le collège solidaire4 et les volontaires impliqués. Puis, en janvier 2020, nous avons démarré l’organisation de notre atelier éducatif de rue hebdomadaire dans le quartier des Mordacs à Champigny-sur-Marne5. Depuis, d’autres activités se sont développées telles que les ateliers « hors les murs » le mercredi. Il s’agit d’expérimenter des centres de loisirs sans locaux, organisés en petits groupes, reposant sur une démarche visant à faciliter la découverte du milieu – envisagée, en pédagogie sociale, comme le fait de s’appuyer sur le quotidien des gens, dans les lieux où ils vivent. Aussi est-il essentiel de bien connaître son quartier, sa ville, ses habitants. Les autres axes de travail de ces ateliers se construisent autour des rencontres et de l’expression des enfants. Enfin, nous réalisons une présence sociale régulière, à la sortie des écoles, dans le quartier, et nous organisons également des séjours de vacances (colos, bivouacs).
Dans cet article, nous partagerons une partie de notre travail en nous appuyant sur deux exemples d’actions que nous mettons en place.
Nous présenterons comment nous construisons des liens avec les personnes que nous rencontrons, mais aussi avec d’autres organisations sur et en dehors de notre périmètre géographique d’intervention.
La construction d’une série d’ateliers avec les enfants et les familles du centre d’accueil des demandeurs d’asile
Nos diverses expériences nous ont permis de constater que la construction des bases d’une relation de confiance passe par l’abandon de l’idée d’avoir a priori un projet à proposer aux habitants, auquel sont associés des objectifs déjà définis en amont.
L’envie de partager le plus longtemps possible des moments ensemble constitue notre point de départ. Les projets et les objectifs qui leur sont associés résultent de la rencontre plutôt qu’ils ne sont le prétexte à la rencontre.
Ce faisant, lorsque nous organisons nos ateliers éducatifs de rue ou nos présences dans l’espace public, nous nous appuyons sur trois principes fondamentaux en pédagogie sociale que sont la gratuité, la régularité et l’accueil inconditionnel. La mise en œuvre de ces principes nous permet d’être davantage disponibles et attentifs à ce qui arrive, à ce qui se vit. Ils instaurent des repères et créent les conditions de la rencontre : l’argent ou l’âge ne sont plus des barrières, tout le monde peut participer, contribuer, et une place est prévue pour chacun et chacune (enfants, parents, adolescents, passants, etc.). La régularité permet quant à elle de laisser aux participant·e·s le temps nécessaire pour se sentir prêt·e·s à la rencontre.
Pour illustrer cet enjeu, je vais m’appuyer sur une série d’ateliers que nous avons organisés en juillet 2021 dans le centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) Miguel d’Estrella, géré par l’association France terre d’asile, à Créteil (94). Lors de nos échanges avec l’équipe du CADA, nous avons posé comme principe que notre travail n’avait d’intérêt que s’il s’inscrivait dans une forme de régularité et qu’il ne pouvait s’agir d’une prestation unique. Nous avons ainsi organisé quatre ateliers et une soirée conviviale chaque jeudi du mois de juillet.
Lors du premier atelier, nous nous sommes installés sur les espaces extérieurs du centre : le parking, les espaces avec des tables et les espaces verts. Très rapidement, plusieurs enfants ont commencé à venir à notre rencontre et à nous proposer leur aide, que nous avons immédiatement acceptée. Les premiers contacts se sont donc établis de manière très concrète en déchargeant notre camion et en installant le matériel. Malgré la barrière de la langue, nous avons joué, dessiné, raconté des histoires et partagé un goûter avec les enfants et les parents qui ont rejoint l’atelier par la suite. Une fois cette rencontre suscitée, il nous fallait développer une relation plus profonde sur le temps dont nous disposions.
Pour le deuxième atelier, nous sommes partis de la même base – l’organisation du goûter – et nous y avons ajouté des jeux en bois. Faciles à manier, ils permettent de faire jouer ensemble les enfants et les adultes. Jouer nous a ainsi permis de mieux connaître les enfants présents et d’évoquer, notamment avec un groupe de jeunes filles somaliennes, l’atelier que nous souhaitions proposer la semaine suivante, dénommé le « spa de rue ». Celui-ci prend la forme d’un salon de beauté mobile, où nous proposons la réalisation de masques de beauté à l’argile et de microhammams faciaux, des massages ainsi qu’une petite manucure. Il s’agissait pour nous de créer pour ce faire un cadre relationnel de confiance propice à leur participation, qui plus est dans le cadre d’une activité en extérieur. Après discussion avec ces jeunes filles, nous avons trouvé collectivement un mode d’organisation pour garantir l’intimité : nous avons apporté, sur le parking du centre, un barnum que nous avons fermé à l’aide d’une toile. Cette installation a ainsi permis la participation de chacun des enfants qui le souhaitait, et les jeunes filles avec lesquelles nous avions imaginé l’activité ont pu avoir un moment pour prendre soin d’elles ensemble. L’organisation de ce type d’atelier facilite l’émergence de la relation de confiance mutuelle que nous recherchons.
Le dernier atelier a consisté en une sortie effectuée avec plusieurs enfants et parents. À cette occasion, nous nous sommes tout d’abord promenés sur un site naturel du département puis nous avons fait des courses en vue de préparer ensemble le repas du soir pour les personnes hébergées au centre. Cela nous a donné l’occasion de réfléchir en amont à un repas pouvant convenir à tous les convives, en tenant compte de la diversité des habitudes alimentaires. Le repas était principalement composé de céréales, légumineuses, légumes et fruits frais. Ce moment convivial a clos notre série d’interventions.
Malgré une part de frustration, due au fait que nous ne reverrions plus ces enfants et ces familles en transit dans leur parcours d’exil, nous avons eu la chance de les rencontrer et de partager, le temps d’un été, quelques moments ensemble.
Cet exemple illustre en quoi la régularité de la présence, le fait d’accepter l’hétérogénéité, de prendre le temps et de prendre chacun et chacune en considération sont des éléments indispensables pour susciter la rencontre et pour approfondir la relation d’atelier en atelier, même sur une courte période.
Les séjours de vacances comme prolongement des ateliers éducatifs de rue
Parallèlement à l’organisation d’ateliers éducatifs, notre association met également en place des séjours de vacances, que nous envisageons comme un moyen de prolonger, d’une autre manière, le travail que nous engageons avec les enfants et leur famille tout au long de l’année. En suivant notre approche, l’organisation des séjours est construite de manière à faciliter les rencontres. C’est pourquoi notre premier séjour de vacances, organisé au printemps 2022, a été pensé de manière à regrouper des enfants de différents horizons, ce qui nous a amenés à travailler avec d’autres organisations.
Le séjour a rassemblé seize enfants de 7 à 14 ans accompagnés d’une équipe pédagogique de quatre personnes. Le groupe se composait de quatre enfants du quartier des Mordacs, où nous organisons notre atelier éducatif de rue hebdomadaire ; de cinq enfants du centre d’hébergement d’urgence de la Croix-Rouge, qui participent eux aussi à nos activités ; et de sept enfants du quartier Opéra de Massy (Essonne6), qui participent, quant à eux, aux activités de l’association Intermèdes Robinson. Bien que participant fidèlement à l’atelier de rue chaque semaine, ces enfants n’avaient jusqu’alors jamais eu l’occasion de partir en vacances avec l’association.
Les relations qui unissent nos deux associations, Tous les Maquis et Intermèdes Robinson, remontent à de nombreuses années. Des liens se sont noués à partir de 2011 lors des chantiers de pédagogie sociale organisés par l’Institut coopératif de l’école moderne-Pédagogie Freinet (ICEM7), et l’activité d’Intermèdes Robinson a été une source d’inspiration pour la création de notre association. Aussi, lorsque nous avons décidé de créer ce séjour de vacances, il nous est apparu évident de l’ouvrir aux enfants accompagnés par Intermèdes Robinson, dont une partie de l’équipe pédagogique a également participé au séjour.
Le séjour nous a conduits à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, où nous avons assisté au Festival international de cerfs-volants. La destination s’est imposée à nous pour au moins deux raisons. Il s’agissait tout d’abord d’un festival populaire, qui nous permettait d’emmener les enfants en bord de mer et d’être dehors avec eux. En outre, nos liens avec l’association Accueil Formation Loisirs (AFL8) implantée dans la commune voisine de Fort-Mahon-Plage nous offraient la possibilité d’être logés durant une semaine, en pension complète, dans son centre d’hébergement. Ce lieu a longtemps abrité des stages de formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et continue d’accueillir des colonies l’été. Dans ce centre à taille humaine, les enfants trouvent leur prénom écrit sur la porte de leur chambre en arrivant. Une boîte à leur nom leur permet de ranger leurs affaires et ainsi de faciliter l’organisation du réveil individualisé et du petit déjeuner échelonné ; tous les espaces étant aménagés en conséquence. Ces attentions aux détails et l’exigence apportée par l’équipe du centre à la qualité de l’accueil sont propices à faciliter les rencontres, dans un cadre sécurisant, où les enfants et les adultes connaissent et passent du temps avec les personnes chargées de la préparation des repas et de l’entretien des locaux.
Notre objectif est de revenir sur place chaque année afin que ce séjour devienne un rituel et un repère pour notre association. La mise en œuvre de cette régularité nous permet en effet de construire d’autres liens, de partir en sachant que l’on pourra revenir et que l’on sera heureux de se revoir, de se donner des nouvelles.
Inscrire la démarche dans une perspective internationale
L’action de notre association s’inscrit, enfin, dans une perspective internationale qui se trouve au cœur du projet éducatif et social que nous défendons – à la fois ancré sur un territoire et ouvert à différentes formes de rencontres.
En 2019, deux membres de notre équipe ont eu l’opportunité de participer, dans cet esprit, à un séjour solidaire en Palestine. Depuis lors, malgré l’épidémie de Covid-19, nous avons maintenu des liens avec le centre d’éducation populaire autogéré de Laylac, situé dans le camp de réfugiés palestiniens de Dheisheh au sud de Bethléem9. Ensemble, nous réfléchissons ainsi à la possibilité de mettre en place une correspondance entre les enfants du centre et ceux que nous accompagnons, mais également à traduire en arabe les livres écrits par les enfants dans le cadre de nos ateliers d’écriture de rue.
Plus récemment, en octobre 2021, nous avons participé, avec plusieurs associations et collectifs, à l’accueil en Europe d’une délégation zapatiste de l’État mexicain du Chiapas, dans le cadre d’un voyage international organisé dans le sillage de l’adoption d’une « Déclaration pour la vie » promouvant l’organisation de rencontres et de dialogues sur chaque continent10. Enfin, nous développons également des liens avec des pédagogues sociaux de Hambourg (en Allemagne) sur la question des terrains d’aventures et avec des pédagogues polonais dans le cadre d’un voyage organisé par l’Institut Helena Radlinska11, réseau national et international de chercheurs et de praticiens de la pédagogie sociale – dénommé en référence à Helena Radlinska, considérée comme l’une des fondatrices de cette approche en Pologne au début du XXe siècle.
Les trois précarités de la pédagogie sociale
Les différentes activités que nous développons au sein de Tous les Maquis nous amènent plus largement à composer avec différentes formes de précarité, tant du point de vue des personnes avec lesquelles nous travaillons qu’en termes organisationnels et de posture professionnelle. Une première forme de précarité tient en effet aux personnes et aux groupes avec lesquels nous développons des liens. Bien qu’elle s’adresse à toutes et à tous, la pédagogie sociale s’exerce le plus souvent auprès de personnes et de groupes confrontés à une fragilité sociale, économique et politique. Il y a ensuite la précarité même des collectifs et des associations qui se revendiquent de la pédagogie sociale. En effet, cette orientation nécessite de travailler dans des conditions humaines, matérielles et financières relativement instables. Enfin, une troisième forme de précarité est celle du manque de repères théoriques de la pédagogie sociale. Comme celle-ci est peu connue en France et qu’elle est avant tout affaire de praticiens, elle ne fait l’objet que de très peu de recherches et n’est quasiment pas enseignée ou transmise, que ce soit à l’université ou en formation professionnelle, notamment dans les champs de l’éducation populaire ou du travail social. Elle souffre, ce faisant, d’un manque de reconnaissance académique. Néanmoins, telle que nous la défendons, la pédagogie sociale n’est peut-être pas riche de biens, mais elle est riche de liens. Cette approche facilite l’émergence d’une diversité de liens de confiance, authentiques et réciproques. Elle contient en elle l’idée que pour créer les conditions de la rencontre, il est nécessaire de faire l’épreuve de l’égalité, de se reconnaitre égaux et, ce faisant, de s’extraire autant que possible des rapports de domination et d’oppression, seule manière de construire de la culture, du savoir et de s’émanciper ensemble.
- Association d’éducation populaire et de pédagogie sociale, Tous les Maquis est installée dans le Val-de-Marne (94). La majeure partie de son activité se concentre dans les quartiers de la politique de la ville, au sein d’hôtels sociaux ou dans les bidonvilles à Champigny-sur-Marne et aux alentours. L’association intervient aux niveaux départemental et régional en tant qu’organisme de formation mais également à un niveau interrégional, dans le cadre d’un travail amorcé avec le groupe de pédagogie et d’animation sociale (GPAS) de Bretagne, sur la formation
au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ainsi qu’avec d’autres associations (Secours populaire, Croix-Rouge, Intermèdes Robinson, GPAS) sur la mise en place de séjours pour les enfants. L’association a également une dimension internationale, à travers sa contribution à l’organisation d’ateliers éducatifs dans deux camps de réfugiés en Palestine occupée. ↩︎ - Quinzaine organisée dans la ville avec des ateliers, des rencontres, les moments conviviaux entre parents, enfants, professionnels. ↩︎
- Voir : [wiki.ruesauxenfants.com] ↩︎
- Le collège solidaire remplace le conseil d’administration. Dans un fonctionnement collégial, les responsabilités sont partagées entre plusieurs personnes qui n’ont pas de lien hiérarchique entre elles. Chacun et chacune est responsable d’une partie de l’activité de l’association et les décisions importantes sont prises ensemble. ↩︎
- Le quartier des Mordacs est un quartier d’environ 5 000 habitants, reconnu au titre de la politique de la ville, situé à l’est de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). ↩︎
- Le quartier Opéra, reconnu au titre de la politique de la ville, est situé à l’est
de la commune de Massy (Essonne). Il regroupe environ 3 500 habitants. ↩︎ - Créé en 1947 par le pédagogue Célestin Freinet, l’ICEM-Pédagogie Freinet « se donne pour objectifs et bases de travail la recherche et l’innovation pédagogiques, la diffusion de la pédagogie Freinet par l’organisation de stages, par la conception, la mise au point et l’expérimentation d’outils pédagogiques pour la classe, de revues documentaires pour les enfants, les jeunes et les enseignants, et l’édition de publications pédagogiques ».
Voir : [icem-pedagogie-freinet.org] ↩︎ - Voir : [afl-hebergement-collectif.com] ↩︎
- Voir : [laylacdo.com] et [fr-fr.facebook.com/Laylac.Center] ↩︎
- Voir : [reporterre.net] et [enlacezapatista.ezln.org] ↩︎
- Voir : [instituthelenaradlinska.fr] ↩︎
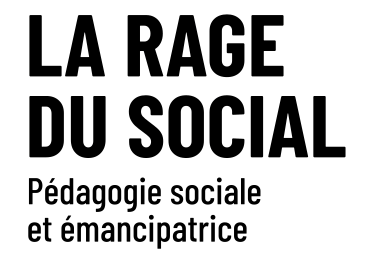
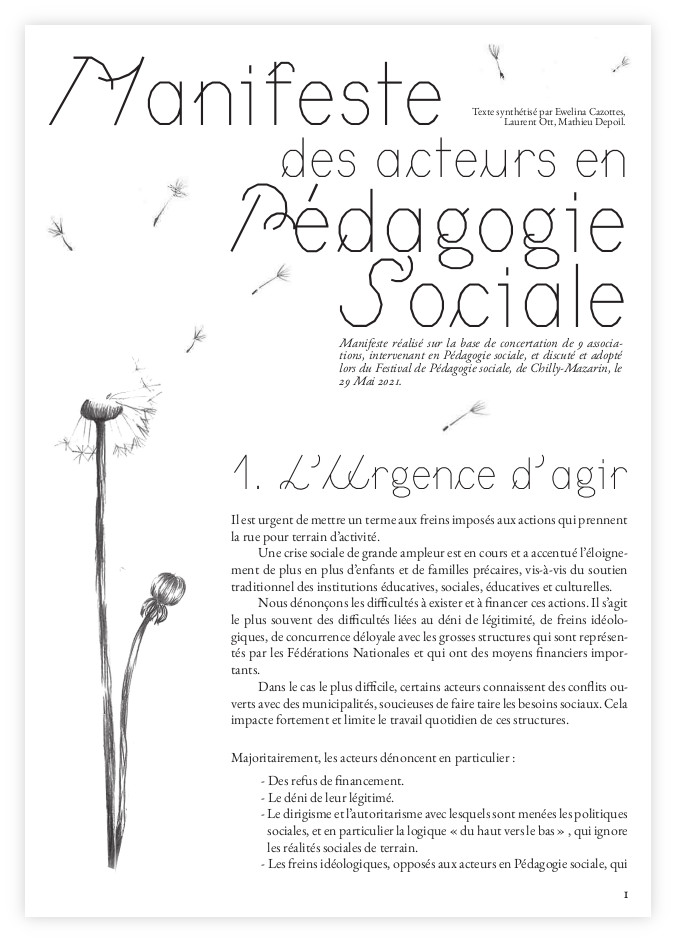
Laisser un commentaire