Par Mathieu Depoil
Depuis le début des années 70, l’éducation populaire s’est vue progressivement soumise à une obligation normative via, entre autres, la technocratisation des fonctionnements associatifs et la segmentation de ses pratiques. Ce phénomène peut se traduire par l’injonction faite aux associations d’éducation populaire de répondre à des attendus spécifiques, éloignés de son projet initial, relayant ainsi les questions pédagogiques à un second plan. Considérant que l’éducation populaire s’inscrit dans l’héritage de la pensée «éducationniste », il paraît important aujourd’hui de réintroduire la notion d’éducation au cœur de ses intentions politiques et ce, malgré les «évolutions » conceptuelles régulièrement imposées par les institutions.
Parce qu’un certain nombre de pédagogues, animateurs·trices, éducateurs·trices pense que l’éducation constitue un des piliers fondamentaux de la transformation de notre société1, il est important de préciser qu’un projet social, ayant pour finalité l’amélioration des conditions de vie des personnes, devrait être pensé en intégrant dans ses fondements cette notion même d’éducation, comme intention, d’une part, mais également comme pratique, d’autre part.
Cette dimension éducative, par exemple, n’est que très partiellement abordée dans les Circulaires relatives à l’animation de la vie sociale éditées par la Caisse Nationale des Allocations Familiales2 permettant de fixer les modalités d’agrément des centres sociaux et de définir les obligations d’orientation de leurs projets d’actions. (Pour illustration, le mot «éducatif » est très peu cité dans la doctrine de 2012 et n’apparaît pas comme étant une finalité3. Concernant la circulaire de 2016, le mot «éducatif » y est absent). Pourtant, les centres sociaux et les structures d’animation de la vie sociale ne sont-ils pas à considérer comme des espaces d’éducation ?
Il est important de préciser que dans ce contexte, le terme «animation », malgré le caractère éducatif intrinsèque à cette pratique, ne se supplante pas à la notion politique d’éducation. Le levier du « social » est donc l’intention prédominante dans ces circulaires au détriment de l’ambition éducative. Cette remarque peut s’appliquer autant sur les aspects du cadre de référence de la doctrine (contenu politique de la circulaire CNAF par exemple) que sur les aspects de construction des modalités d’intervention relatives à chaque organisateur, conférant majoritairement la dimension éducative aux Accueils Collectifs de Mineurs sous forme de projet éducatif et projet pédagogique. Dans ce sens, le mot «éducatif » semble cantonné et attribué à des services extra ou périscolaires adressés aux enfants et aux jeunes, excluant ainsi la notion «d’éducation tout au long de la vie» de la construction et la mise en œuvre d’un projet social à destination de tous les publics. L’absence de cette dimension d’éducation permanente peut laisser penser que le processus de «participation des habitants», par exemple, n’est pas assimilé à un principe émancipateur car détaché de toute aspiration politique, limitant cette notion de «participation » à la prise en compte des besoins des personnes dans le cadre d’un projet. A notre sens, l’approche éducative d’un projet social a pour finalité le changement et non l’adaptation4, cette distinction étant essentielle dans la perspective de lutte contre le fatalisme éducatif5 et le rejet d’une nécessaire adaptation à une réalité que nous faisons le choix de transformer plutôt que de subir. Alors pourquoi ne pas conjuguer l’éducatif et le social ?
Le social et l’éducatif ensemble
S’intéresser à l’éducation dans le cadre d’un projet d’agrément «centre social», c’est s’intéresser au processus de construction des conditions nécessaires à davantage de justice sociale par l’acquisition des savoirs indispensables à l’autonomie et à l’émancipation collective des personnes. A travers cette approche, l’action d’éducation n’est plus considérée comme secondaire, ou comme un potentiel outil au service du lien social, mais comme un objet de lutte. S’intéresser à l’éducation, c’est s’intéresser, non pas à la méthode, ou à la technique et encore moins au dispositif, mais à la volonté de passer de la posture de technicien·ne du système social à la posture d’éducateur ou éducatrice populaire en agissant aussi bien sur la capacité à penser que celle d’agir : une praxis de transformation sociale et politique6. S’intéresser à l’éducation, c’est s’intéresser à la «force créatrice»7 des personnes et leurs capacités à acquérir un regard critique sur le monde. Dans ce cas, l’acte éducatif devient alors central dans la démarche du travail dit du « social » à l’inverse d’un acte prescriptif teinté de domination institutionnelle, dans le sens de la reproduction des systèmes d’inégalité et de dépendance. La distinction entre «éducatif » et «_social » ne trouve pas sa réconciliation dans l’animation dite «_socioculturelle » ni même dans le «_loisir éducatif»8 mais dans une approche croisée entre le social, dans sa dimension humaniste et attentive aux plus précaires, et l’éducatif dans sa dimension émancipatrice avec la volonté de transformer la réalité par l’acte pédagogique. S’intéresser à l’éducation, c’est s’intéresser à la capacité de grandir tout au long de sa vie. Il n’est pas toujours chose aisée de définir, d’organiser, de construire un projet alliant l’ensemble de ces dimensions. L’alliance du travail du social et de l’éducatif peut trouver écho, à notre sens, dans la pédagogie.
Mais alors ? Qu’est-ce que la pédagogie ?
La pédagogie organise la pensée éducative. Elle traduit les intentions en actes, les idées en mouvements, les sensibilités en choix. La pédagogie définit les gestes de la main et le sens de la parole. Elle n’est pas didactique. Elle n’est pas seulement l’art de transmettre ou d’enseigner. Elle pourrait surtout être l’art d’organiser l’émancipation. Elle n’est pas méthode, elle n’est pas technique, elle est processus. La pédagogie est à l’image de la vie des personnes : en permanente évolution. Dans chaque projet, cette part «d’agir» ne doit pas être laissée au hasard : la pédagogie doit être conscientisée.
L’exemple du traitement pédagogique de la notion «d’égalité» peut éclairer ce propos. Combien y aurait-il de déclinaisons pédagogiques possibles au principe «d’égalité » ? Beaucoup… Dans certaines organisations, l’égalité serait par exemple d’habiller l’ensemble des personnes à l’identique afin d’effacer les éventuelles inégalités sociales donnant ainsi naissance à l’uniformisation et à son lot de dérives potentielles (uniformisation de la pensée, effacement des singularités, restrictions des libertés, etc.). Dans d’autres lieux et d’autres organisations, l’égalité pourrait prendre la forme, par exemple, de libre choix de style, d’allure, de classe : tous égaux mais tous différents donc libres d’être multiples. A l’inverse de la première hypothèse de l’uniformisation, ce choix-là ouvrirait la réflexion sur la place de l’individualité au sein d’un collectif sous-entendant alors la question de la dérive individualisante (culte de la personne, pratique individualisante, la question des communs, égoïsme, etc.). Dans ces deux exemples volontairement caricaturaux de par leurs déclinaisons opérationnelles contraires, nous pouvons voir l’impact politique de nos choix pédagogiques : la tension entre égalité et liberté. Dans ce cas-là, nous parlons bel et bien de pédagogie : comment organiser notre fonctionnement afin qu’il corresponde à notre visée politique émancipatrice ? La pédagogie peut nous amener une troisième voie entre ces deux visions des pratiques de l’égalité: trouver un équilibre entre le «tous pareil» et le «chacun pour soi» permettant de considérer la personne au sein d’un groupe et en prenant conscience que nous ne pouvons être libres qu’en interaction avec les autres et que nous ne pouvons être libres seuls.
En quoi la pédagogie peut-elle transformer la réalité ?
La pédagogie est donc fondamentalement politique9. Derrière l’idée ou la pensée, il y a une orientation, une direction, un désir de transformation. Derrière un mot ou un discours, s’en suivra un acte. Derrière une idée, s’en suivra une décision. Parce qu’éduquer n’est jamais neutre, la pédagogie ne peut être qu’un engagement. Parce que la politique est la vie de la cité et nos choix et envies sont d’y participer activement. Pour ne pas rester en dépendance des puissants, nos choix sont donc éducatifs et politiques, à l’image du peuple: décloisonnés, et volontairement en lien avec la question sociale. C’est sur ce point que la jonction peut de nouveau exister entre social et éducatif, autour d’une pédagogie qui s’inscrit dans une dimension de ce qui fait «société » et de ce qui fait lien, pour une éducation populaire agissant dans une globalité, indépendamment des dispositifs et sans critérisation des publics. De ce fait, la pédagogie que nous évoquons doit être celle de l’auto-éducation collective et émancipatrice: se conscientiser et s’organiser pour agir ensemble.
Le travail social, dans une dimension d’animation de la vie sociale et d’éducation populaire, peut se construire sur cette proximité éducative et pédagogique inspirée des pédagogues sociaux10 : le travail du groupe, de la culture, à partir des besoins repérés des personnes, inscrit dans le milieu de vie et fixant son objectif dans la transformation sociale : sortir des rapports sociaux de domination et d’exclusion et repositionner la «question sociale» au cœur des préoccupations de l’éducation populaire.
Références bibliographiques / Sources :
1 Nota : l’auteur fait référence ici aux pédagogies émancipatrices inspirées des courants libertaires
2 Circulaire CNAF n°2012-013 et n°2016-005
3 Circulaire CNAF n°2012-013 – p.8 – Partie 22
4 De Cock L. et Pereira I., Les pédagogies critiques, ANGONE, 2018, p. 26 -27
5 Freire P., Pédagogie de l’autonomie, Toulouse, Eres, 2006, p.57 et 79
6 Maurel C, Éducation populaire et puissance d’agir, Paris, L’Harmattan, 2010
7 Chomsky N., Pour une éducation humaniste, L’Herne, 2010, p.11-15
8 Lebon F. et De Lescure E., L’éducation populaire au tournant du XXIe siècle, Edition Du croquant, 2016, p 63-72
9 Wagnon S., N’Autre école, n°14, Entretien, Pour une pédagogie solidaire, p.14-17
10 Ott L., Pédagogie sociale, Chronique Sociale, p. 13-15
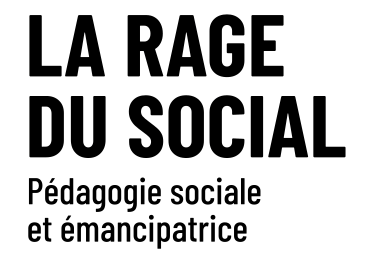
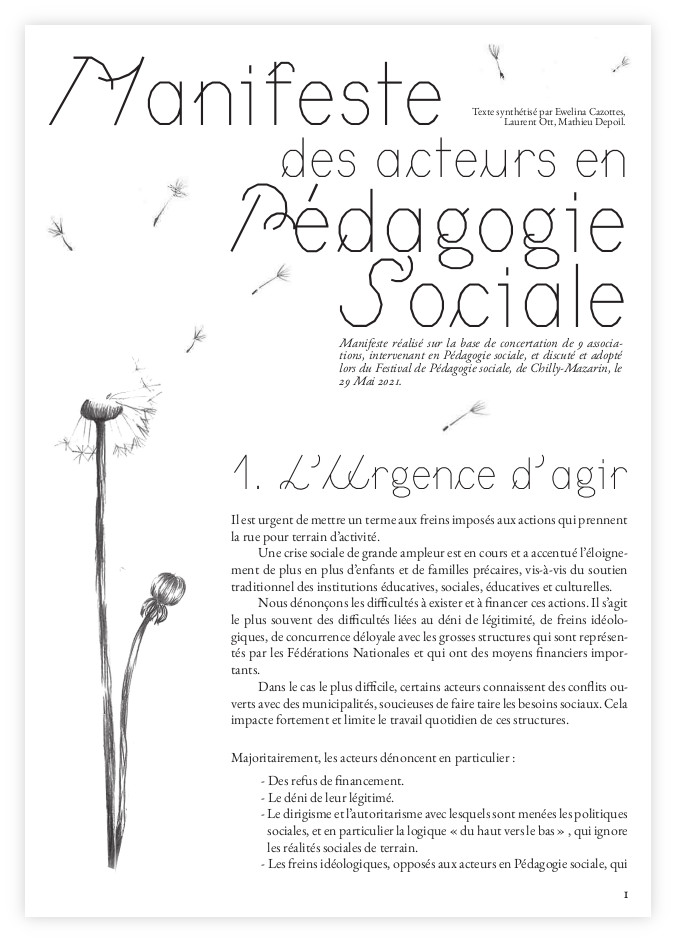
Laisser un commentaire