Par Pierre Dugué
Dans notre dernier article, nous évoquions la manière dont les nouvelles générations d’éducateurs envisageaient leur rapport au travail. Formés en rupture d’avec les logiques de passation par les pairs, ils témoignent d’une nouvelle façon de considérer leur professionnalisation. De ce changement de paradigme émergent des collaborations générationnelles contrariées, des frictions importantes. Quels éléments peuvent nous permettre d’éclairer le choc des mondes ?
Le langage
Les nouvelles générations d’éducateurs, formées selon les règles matricielles compétentielles, font preuve d’une singularité langagière surprenante. Très éloignés du langage des « baby-boomers », les jeunes professionnels ont dorénavant recours à un vocabulaire très spécifique, fortement emprunté à un langage professionnel codifié, une sorte de novlangue éthico-managériale, qui s’articule autour de concepts aujourd’hui très largement diffusés dans le secteur médico-social.
L’arrivée de cette nouvelle sémantique n’est pas sans relation avec l’impact qu’a eu la loi de 2002-2 dans ce processus mutationnel. En effet, la très « emblématique » loi rénovant l’action sociale et médico-sociale a largement diffusé l’idée de l’imposition d’un « social de gestion » qui introduit une forte porosité à l’égard de la logique de marché. Ces transformations qui participent, pour certains auteurs, à la servuction du secteur médico-social ont « permis l’avènement d’une novlangue dont les termes les plus fréquents sont maintenant bien repérables : démarche qualité, projet, prestation, client ou bénéficiaire, bien-être… » 1 (Gallut X., Qribi A., 2010).
Ces changements langagiers traduisent le fait que le travail social est une activité hautement paradoxale, certains diront même que « les paradoxes constituent presque une clé de voûte dans la compréhension de cette nébuleuse apte à décourager toute catégorisation rationnelle »2 (Cambon L., 1995). Nommer des activités paradoxales n’est pas chose aisée. Il faut des mots propices à leur acceptation pour donner chair(e) à des activités qui, si elles ne pouvaient se nommer, renverraient le sujet à ses propres contradictions.
Pour nous, l’incorporation de la novlangue médico-sociale sert aujourd’hui à légitimer et à imposer, sans le dire réellement, de nombreuses injonctions paradoxales véhiculées par des institutions sociales paradoxantes.
L’essor d’un pragmatisme responsabilisant
Les nouvelles générations de travailleurs sociaux que nous avons rencontrées s’éloignent très clairement de l’approche militante/empirique revendiquée par leurs aînés. Les bases identitaires professionnelles, qui reposaient auparavant sur des valeurs militantes politiques de type marxistes, s’effacent progressivement devant l’émergence d’une implication raisonnée. Les jeunes professionnels s’appuient dorénavant sur une conception particulièrement légitimiste de leur activité ; leur entrée dans la carrière de travail social est pensée au service du défi de soi qui facilite la vérification de la capacité du sujet dans sa quête adaptative et trouve, de fait, un écho certain avec l’approche projet du management stratégique.
A ce titre, plus on s’intéresse au récit expérientiel des professionnels nouvellement formés, plus on distingue une érosion des fondations politiques jouant un rôle moteur dans le désir d’entrée dans la carrière éducative. Dorénavant, « la sacralité du modèle s’éloigne et la forme de la vocation se modifie »3 (Dubet F., 2006) puisque ce sont surtout les opportunités professionnelles et la logique du marché du travail qui semblent présider au choix de s’investir dans le champ du travail social.
Auparavant les professionnels décidaient de leur orientation professionnelle en fonction de principes et de valeurs étroitement liés à leurs activités militantes et politiques. Désormais, ce qui préoccupe davantage les jeunes professionnels, c’est d’exploiter les espaces d’autonomie des cadres professionnels leur servant à rompre avec la sphère disciplinaire scolaire. L’autonomie fonctionnelle, la liberté d’intervention sont de fait recherchées et désirées par les néo professionnels qui se « crantent » plus aisément avec le système managérial.
Une nouvelle sémantique
Parallèlement à ces transformations identitaires, nous avons pu constater, à travers l’analyse des récits expérientiels, que la sémantique professionnelle, de type marxiste, mobilisée dans la phraséologie des anciens professionnels, avait tendance à disparaître du discours des jeunes professionnels. Cette mutation sémantique produirait, au-delà des mots, un impact considérable sur l’agir professionnel. Cette rupture avec le modèle vocationnel engagé générerait un télescopage générationnel professionnel. Selon nous, les différentes générations professionnelles ne se comprendraient plus.
L’avènement de l’individu total ?
Cette césure relationnelle et identitaire produit des effets d’individualisation sur les collaborations professionnelles. Les individus cohabiteraient dans un même espace professionnel sans pour autant éprouver le sentiment d’appartenir à un « corps professionnel », pas plus que de « faire équipe ». De nombreux malaises et conflits de valeurs seraient porteurs de désaccords profonds sur le sens même des actions engagées. Ce que nous disent les praticiens, c’est que d’un point de vue opérationnel, la clinique éducative « d’antan », basée sur une relation de type maïeutique, laisserait la place à une approche visant à la gestion des parcours individuels des publics accueillis. De la tentative de faire émerger un sujet singulier, basée sur une posture clinique éducative4 conscientisante (Niewiadomski C., 2012), nous passerions à l’émergence d’une clinique individualisante-responsabilisante.
Le secteur médico-social a bouclé une première mutation, celle du langage. Les mots servent à dire, ils créent aussi la pensée, l’agir. L’arrivée massive de prescriptions visant à l’ingénierie ont engagé les néo-professionnels du travail social sur la pente de la post modernité. Aujourd’hui, le social repose sur l’idée de « mettre l’individu en projet dans le cadre d’une contractualisation devant matérialiser son autonomie et sa responsabilité »5 (Monceau G., 2009). La responsabilisation devient maître mot. Elle part du postulat que l’individu peut, s’il le désire réellement, modifier sa trajectoire individuelle.
Pour autant, nous éprouvons le sentiment que cet état des choses n’est pas suffisant pour alimenter notre réflexion. Nous rencontrons de plus en plus de travailleurs du social alternatif, hybridés par des apprentissages métissés, très éloignés des métiers canoniques. En rupture d’avec des modèles paternalistes véhiculés par les institutions sous tutelle de la puissance publique, ils échappent aux logiques tubulaires des « bonnes pratiques ». Ils se nourrissent du présent, car la précarité est leur quotidien. Quel est leur avenir… ?
Références bibliographiques / Sources :
1 Gallut X., Qribi A., La démarche qualité dans le champ médico-social, Toulouse, Erès, 2010
2 Cambon L., L’éducateur spécialisé à travers ses discours : une question d’identité, thèse soutenue à l’université de Haute Bretagne, Citant Vilbrod A., Devenir éducateur une affaire de famille, Paris, L’Harmattan, 1995
3 Dubet F., Au-delà de la crise : le « cas » du travail social. Empan, no 61(1), 138-145,2006
4 Niewiadomski C.,. Recherche biographique et clinique narrative. Entendre et écouter le sujet contemporain., Toulouse, Erès, 2012
5 Monceau G., L’individualisation contre l’individuation ? Diversité, ville, école, intégration, n° 157., 2009
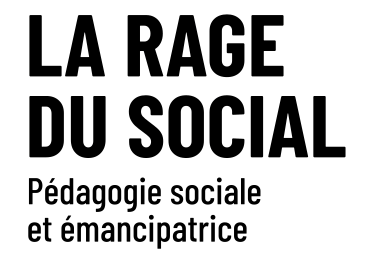
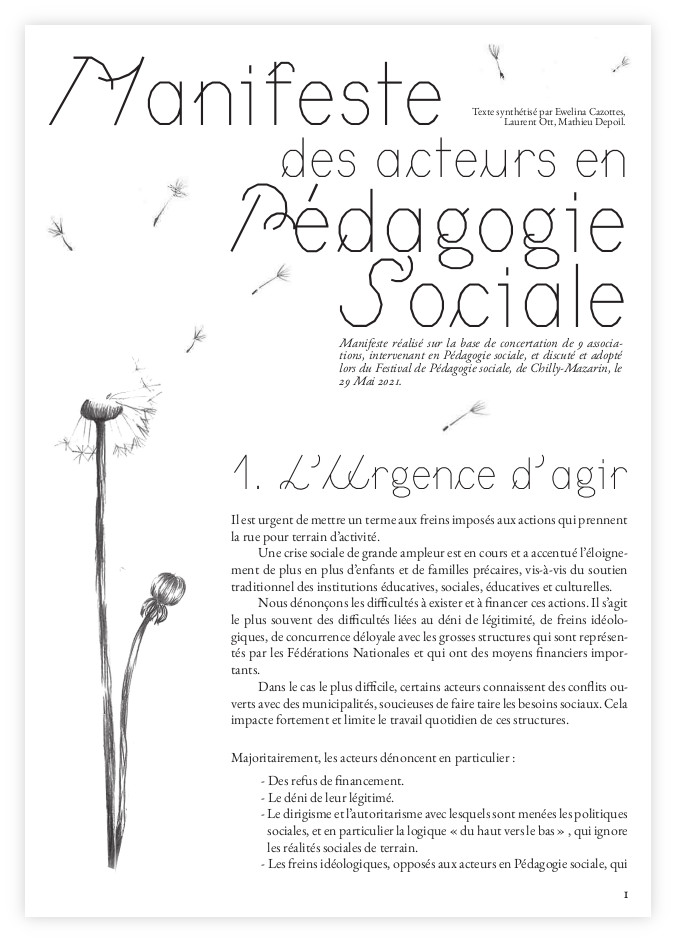
Laisser un commentaire